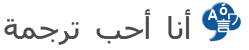- النص
- تاريخ
INTRODUCTION1Dans le nouvel environ
INTRODUCTION
1
Dans le nouvel environnement dans lequel s’exercent les relations internationales depuis la fin de la guerre froide et depuis l’accélération des techniques de communication, les gouvernements ainsi que les parlements d’un nombre croissant d’États s’interrogent sur la forme que pourrait prendre une réorganisation ou un redéploiement de la « représentation à l’étranger » et des services de politique extérieure au sein de l’administration. Il s’agit en particulier de pouvoir mieux défendre ou promouvoir les intérêts du pays, notamment en proposant des innovations dans le domaine des compétences, sans pour autant sacrifier aux obligations découlant d’une protection due aux ressortissants actifs ou résidents dans les pays étrangers. Le défi n’est pas mince pour les administrations si l’on se réfère par exemple aux considérations développées en France et en Suisse, pour ne mentionner que ces deux pays [1]
[1] Cf. Assemblée nationale française. Commission des...
.
2
C’est justement par rapport à ces évaluations en cours sur la manière optimale d’organiser les services diplomatiques au XXe siècle que les historiens peuvent apporter quelques éclairages sur la manière dont les gouvernements ont pris en compte aussi bien les nouvelles dimensions qui se sont imposées dans les affaires internationales que sur la façon d’y répondre sur le plan pratique au sein des administrations gouvernementales. D’où l’idée de ce présent numéro de notre revue sur les nouveaux outils de la diplomatie au XXe siècle.
3
Certes, les historiens des relations internationales se sont beaucoup investis dans l’analyse des aspects les plus divers dont l’identification leur permet de comprendre les changements significatifs qui se sont imposés dans les sociétés contemporaines, entraînées dans un processus longtemps qualifié d’internationalisation, puis plus récemment de mondialisation. En parcourant les tables des matières des 120 numéros de la revue Relations internationales, parus depuis 1974, on ne peut que constater la variété des thèmes abordés ; une part considérable des articles publiés est consacrée à la prise en compte de ces « forces profondes » qui agissent au cœur des relations internationales, selon la formule développée par Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle [2]
[2] Dans la désormais classique Introduction à l’histoire...
. Quant aux pratiques diplomatiques elles-mêmes, qui traduisent ou accompagnent les transformations des conditions politiques, économiques et sociales dont le monde contemporain est le théâtre, sans oublier les révolutions dans les techniques de communication entre les hommes, elles méritent elles aussi d’être analysées. Cela n’a pas échappé aux animateurs de notre revue, puisqu’elle a publié plusieurs contributions sur « les formes nouvelles de la diplomatie au XXe siècle » (nos 31 et 32) ; c’était il y a plus de vingt ans ! D’autres études ont été publiées sur certaines activités spécifiques qui se sont introduites progressivement dans la pratique diplomatique ; chacune des innovations organisationnelles a suscité des débats souvent intenses entre « généralistes » et « spécialistes » qu’il s’agit d’intégrer dans la mise en œuvre de la politique extérieure et notamment dans les lieux hautement symboliques que sont les postes diplomatiques à l’étranger.
4
Ainsi, la création des fonctions d’attaché militaire, commercial, financier ou culturel a fait l’objet de recherches spécifiques ou a été abordée de façon indirecte dans des études plus vastes ; l’apparition plus récente d’attachés sociaux, scientifiques et humanitaires mériterait elle aussi d’être prise en compte. Mais, par-delà l’étude de ces nouvelles fonctions de diplomatie sectorielle, il y a encore beaucoup à faire pour démontrer les interactions entre les « dossiers » gérés par les différentes administrations concernées ainsi qu’entre ces administrations elles-mêmes, dans la formulation ou la conduite des affaires extérieures des États. À cet égard, la consultation des collections de documents diplomatiques publiés fournit des indications précieuses sur cette extension du champ d’action des diplomaties des États et sur les solutions apportées à l’intégration des nouveaux secteurs d’activités diplomatiques dans la politique extérieure globale des gouvernements.
5
De toute évidence, les innovations sur le plan administratif apparaissent en fonction des besoins dûment reconnus par les gouvernements, mais elles ne comportent pas nécessairement la réciprocité dans les pratiques diplomatiques qui caractérise en général la représentation diplomatique sur le plan protocolaire. En effet, la grande majorité des États ne dispose pas de ressources suffisantes pour étoffer chacun de leurs postes diplomatiques par l’engagement d’autant d’agents que de fonctions identifiées. Par ailleurs, l’apparition des organisations internationales, qu’elles soient régionales ou universelles, politiques ou techniques, a contraint aussi la plupart des États à accorder des ressources croissantes à la conduite de la diplomatie multilatérale, phénomène qui a été analysé et systématisé dans les nos 39 et 40 de notre revue en 1984, notamment avec les contributions de Jean-Baptiste Duroselle et Jacques Freymond, fondateurs de la revue.
6
Or, ce qui était identifié à l’époque comme un fait relativement nouveau de la pratique diplomatique a connu des développements impressionnants depuis lors, sans que pour autant les relations bilatérales se soient amenuisées. Bien au contraire, la médiation de l’État dans les activités humaines n’a cessé de prendre de l’importance, au point qu’il devient de plus en plus difficile de dresser une limite dans quelque secteur que ce soit entre la politique intérieure et la politique extérieure dans nos sociétés de plus en plus interpénétrées et interactives sur le plan des échanges et des communications. On peut ainsi constater que la plupart des politiques dites « sectorielles » connaissent des prolongements internationaux et inversement, que ce soit sous l’angle multilatéral ou bilatéral. Pour la conduite des relations extérieures, cela entraîne des conséquences significatives, en ce sens que le gouvernement doit recourir de plus en plus à des agents qui proviennent des divers secteurs spécialisés de l’administration. Autrement dit, les diplomates ne sont plus les intermédiaires uniques et privilégiés entre les États.
7
Si, en effet, pendant longtemps les diplomates, représentant leurs États respectifs, ont eu le monopole dans l’exercice de la diplomatie, ils ont dû progressivement partager une partie substantielle de la défense des intérêts de leurs pays avec d’autres agents qui ne satisfont pas nécessairement aux mêmes impératifs de la vie internationale, ni aux mêmes pratiques. Par ailleurs, de nouveaux réseaux de compétences et d’intérêts se sont mis en place. D’autres acteurs que les États, notamment les organisations internationales, ont pris une place croissante dans les affaires mondiales [3]
[3] Cf. nos 75 et 76 de Relations internationales sur...
; enfin, d’autres instances qui jouissent de statuts particuliers comme le Saint-Siège ou le Comité international de la Croix-Rouge représentent une pratique originale tant sur le plan de la forme que des aspects dont elles s’occupent ; il conviendrait aussi d’y ajouter la myriade d’associations, notamment les ONG dont l’influence est parfois redoutable pour les États, selon les intérêts et les enjeux qu’elles représentent.
8
Au regard de la complexité des questions et des solutions qu’implique l’intégration de nouveaux outils dans la conduite de la politique extérieure, nous sommes bien conscients que l’ambition affichée ici est sans doute trop élevée, puisque nous ne pouvons publier que six contributions ; mais notre objectif serait déjà correctement honoré si nous réussissions à suggérer l’importance du travail de recherche à faire dans le domaine des pratiques diplomatiques par rapport à une société contemporaine engagée dans un processus accéléré de transformation à l’échelle mondiale. Les contributions proposées ouvrent, chacune sur un aspect particulier, une dimension nouvelle de pratiques et d’enjeux diplomatiques ; elles indiquent autant de chantiers de recherche qui s’offrent aux historiens des relations internationales, avant qu’ils ne puissent proposer une éventuelle pondération de l’influence sur la formulation de la politique extérieure des divers « secteurs » qui contribuent à tisser la grande toile de l’action diplomatique.
9
On retiendra par ailleurs que même les pratiques de la diplomatie dans sa forme la plus traditionnelle évoluent : il est clair que la partie représentative, pour ne pas dire mondaine, de la diplomatie a considérablement reculé par rapport aux fonctions plus modernes : on n’imagine plus une ambassade de quelque importance sans un diplomate spécialisé dans les rapports avec la presse, et tous les diplomates sont impliqués dans les questions économiques, pas seulement les attachés spécialisés. D’autre part, les moyens modernes de communication ont contribué à révolutionner l’activité diplomatique, par rapport à l’époque, pas si lointaine, des télégrammes péniblement chiffrés et déchiffrés à la main : la télécopie (chiffrée !), l’ordinateur et l’Internet font désormais partie des outils de travail du diplomate, modifient les conditions de son activité, modifieront aussi les méthodes de travail des futurs historiens [4]
[4] Pour un exemple des années 1950 : Georges-Henri Soutou,...
.
10
Dans leur contribution respective, les six auteurs abordent chacun des dimensions ou des aspects très différents les uns par rapport aux autres. Ainsi, la diplomatie économique multilatérale est abordée par Stanislas Jeannesson, qui illustre son propos en analysant plus particulièrement le rôle d’un des grands artisans français de l’action économique sur le plan international
1
Dans le nouvel environnement dans lequel s’exercent les relations internationales depuis la fin de la guerre froide et depuis l’accélération des techniques de communication, les gouvernements ainsi que les parlements d’un nombre croissant d’États s’interrogent sur la forme que pourrait prendre une réorganisation ou un redéploiement de la « représentation à l’étranger » et des services de politique extérieure au sein de l’administration. Il s’agit en particulier de pouvoir mieux défendre ou promouvoir les intérêts du pays, notamment en proposant des innovations dans le domaine des compétences, sans pour autant sacrifier aux obligations découlant d’une protection due aux ressortissants actifs ou résidents dans les pays étrangers. Le défi n’est pas mince pour les administrations si l’on se réfère par exemple aux considérations développées en France et en Suisse, pour ne mentionner que ces deux pays [1]
[1] Cf. Assemblée nationale française. Commission des...
.
2
C’est justement par rapport à ces évaluations en cours sur la manière optimale d’organiser les services diplomatiques au XXe siècle que les historiens peuvent apporter quelques éclairages sur la manière dont les gouvernements ont pris en compte aussi bien les nouvelles dimensions qui se sont imposées dans les affaires internationales que sur la façon d’y répondre sur le plan pratique au sein des administrations gouvernementales. D’où l’idée de ce présent numéro de notre revue sur les nouveaux outils de la diplomatie au XXe siècle.
3
Certes, les historiens des relations internationales se sont beaucoup investis dans l’analyse des aspects les plus divers dont l’identification leur permet de comprendre les changements significatifs qui se sont imposés dans les sociétés contemporaines, entraînées dans un processus longtemps qualifié d’internationalisation, puis plus récemment de mondialisation. En parcourant les tables des matières des 120 numéros de la revue Relations internationales, parus depuis 1974, on ne peut que constater la variété des thèmes abordés ; une part considérable des articles publiés est consacrée à la prise en compte de ces « forces profondes » qui agissent au cœur des relations internationales, selon la formule développée par Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle [2]
[2] Dans la désormais classique Introduction à l’histoire...
. Quant aux pratiques diplomatiques elles-mêmes, qui traduisent ou accompagnent les transformations des conditions politiques, économiques et sociales dont le monde contemporain est le théâtre, sans oublier les révolutions dans les techniques de communication entre les hommes, elles méritent elles aussi d’être analysées. Cela n’a pas échappé aux animateurs de notre revue, puisqu’elle a publié plusieurs contributions sur « les formes nouvelles de la diplomatie au XXe siècle » (nos 31 et 32) ; c’était il y a plus de vingt ans ! D’autres études ont été publiées sur certaines activités spécifiques qui se sont introduites progressivement dans la pratique diplomatique ; chacune des innovations organisationnelles a suscité des débats souvent intenses entre « généralistes » et « spécialistes » qu’il s’agit d’intégrer dans la mise en œuvre de la politique extérieure et notamment dans les lieux hautement symboliques que sont les postes diplomatiques à l’étranger.
4
Ainsi, la création des fonctions d’attaché militaire, commercial, financier ou culturel a fait l’objet de recherches spécifiques ou a été abordée de façon indirecte dans des études plus vastes ; l’apparition plus récente d’attachés sociaux, scientifiques et humanitaires mériterait elle aussi d’être prise en compte. Mais, par-delà l’étude de ces nouvelles fonctions de diplomatie sectorielle, il y a encore beaucoup à faire pour démontrer les interactions entre les « dossiers » gérés par les différentes administrations concernées ainsi qu’entre ces administrations elles-mêmes, dans la formulation ou la conduite des affaires extérieures des États. À cet égard, la consultation des collections de documents diplomatiques publiés fournit des indications précieuses sur cette extension du champ d’action des diplomaties des États et sur les solutions apportées à l’intégration des nouveaux secteurs d’activités diplomatiques dans la politique extérieure globale des gouvernements.
5
De toute évidence, les innovations sur le plan administratif apparaissent en fonction des besoins dûment reconnus par les gouvernements, mais elles ne comportent pas nécessairement la réciprocité dans les pratiques diplomatiques qui caractérise en général la représentation diplomatique sur le plan protocolaire. En effet, la grande majorité des États ne dispose pas de ressources suffisantes pour étoffer chacun de leurs postes diplomatiques par l’engagement d’autant d’agents que de fonctions identifiées. Par ailleurs, l’apparition des organisations internationales, qu’elles soient régionales ou universelles, politiques ou techniques, a contraint aussi la plupart des États à accorder des ressources croissantes à la conduite de la diplomatie multilatérale, phénomène qui a été analysé et systématisé dans les nos 39 et 40 de notre revue en 1984, notamment avec les contributions de Jean-Baptiste Duroselle et Jacques Freymond, fondateurs de la revue.
6
Or, ce qui était identifié à l’époque comme un fait relativement nouveau de la pratique diplomatique a connu des développements impressionnants depuis lors, sans que pour autant les relations bilatérales se soient amenuisées. Bien au contraire, la médiation de l’État dans les activités humaines n’a cessé de prendre de l’importance, au point qu’il devient de plus en plus difficile de dresser une limite dans quelque secteur que ce soit entre la politique intérieure et la politique extérieure dans nos sociétés de plus en plus interpénétrées et interactives sur le plan des échanges et des communications. On peut ainsi constater que la plupart des politiques dites « sectorielles » connaissent des prolongements internationaux et inversement, que ce soit sous l’angle multilatéral ou bilatéral. Pour la conduite des relations extérieures, cela entraîne des conséquences significatives, en ce sens que le gouvernement doit recourir de plus en plus à des agents qui proviennent des divers secteurs spécialisés de l’administration. Autrement dit, les diplomates ne sont plus les intermédiaires uniques et privilégiés entre les États.
7
Si, en effet, pendant longtemps les diplomates, représentant leurs États respectifs, ont eu le monopole dans l’exercice de la diplomatie, ils ont dû progressivement partager une partie substantielle de la défense des intérêts de leurs pays avec d’autres agents qui ne satisfont pas nécessairement aux mêmes impératifs de la vie internationale, ni aux mêmes pratiques. Par ailleurs, de nouveaux réseaux de compétences et d’intérêts se sont mis en place. D’autres acteurs que les États, notamment les organisations internationales, ont pris une place croissante dans les affaires mondiales [3]
[3] Cf. nos 75 et 76 de Relations internationales sur...
; enfin, d’autres instances qui jouissent de statuts particuliers comme le Saint-Siège ou le Comité international de la Croix-Rouge représentent une pratique originale tant sur le plan de la forme que des aspects dont elles s’occupent ; il conviendrait aussi d’y ajouter la myriade d’associations, notamment les ONG dont l’influence est parfois redoutable pour les États, selon les intérêts et les enjeux qu’elles représentent.
8
Au regard de la complexité des questions et des solutions qu’implique l’intégration de nouveaux outils dans la conduite de la politique extérieure, nous sommes bien conscients que l’ambition affichée ici est sans doute trop élevée, puisque nous ne pouvons publier que six contributions ; mais notre objectif serait déjà correctement honoré si nous réussissions à suggérer l’importance du travail de recherche à faire dans le domaine des pratiques diplomatiques par rapport à une société contemporaine engagée dans un processus accéléré de transformation à l’échelle mondiale. Les contributions proposées ouvrent, chacune sur un aspect particulier, une dimension nouvelle de pratiques et d’enjeux diplomatiques ; elles indiquent autant de chantiers de recherche qui s’offrent aux historiens des relations internationales, avant qu’ils ne puissent proposer une éventuelle pondération de l’influence sur la formulation de la politique extérieure des divers « secteurs » qui contribuent à tisser la grande toile de l’action diplomatique.
9
On retiendra par ailleurs que même les pratiques de la diplomatie dans sa forme la plus traditionnelle évoluent : il est clair que la partie représentative, pour ne pas dire mondaine, de la diplomatie a considérablement reculé par rapport aux fonctions plus modernes : on n’imagine plus une ambassade de quelque importance sans un diplomate spécialisé dans les rapports avec la presse, et tous les diplomates sont impliqués dans les questions économiques, pas seulement les attachés spécialisés. D’autre part, les moyens modernes de communication ont contribué à révolutionner l’activité diplomatique, par rapport à l’époque, pas si lointaine, des télégrammes péniblement chiffrés et déchiffrés à la main : la télécopie (chiffrée !), l’ordinateur et l’Internet font désormais partie des outils de travail du diplomate, modifient les conditions de son activité, modifieront aussi les méthodes de travail des futurs historiens [4]
[4] Pour un exemple des années 1950 : Georges-Henri Soutou,...
.
10
Dans leur contribution respective, les six auteurs abordent chacun des dimensions ou des aspects très différents les uns par rapport aux autres. Ainsi, la diplomatie économique multilatérale est abordée par Stanislas Jeannesson, qui illustre son propos en analysant plus particulièrement le rôle d’un des grands artisans français de l’action économique sur le plan international
0/5000
مقدمة1في البيئة الجديدة للعلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة، ومنذ الإسراع بالاتصال بالتقنيات، شكك الحكومات والبرلمانات في عدد متزايد من الدول النموذج الذي يمكن أن تأخذ عملية إعادة التنظيم أو إعادة انتشار «تمثيل في الخارج» وخدمات للسياسة الخارجية داخل الإدارة. الأمر لا سيما أن تكون قادرة على الدفاع عن أفضل وتعزيز مصالح البلد، بما في ذلك عن طريق تقديم الابتكارات في المجال المهارات، ودون التضحية بمتطلبات الواجب حماية رعاياها المقيمين أو الأصول في البلدان الأجنبية. أن التحدي ليس رقيقة للسلطات إذا كان أحد يشير على سبيل المثال إلى الاعتبارات التي طورت في فرنسا وسويسرا، ناهيك عن أن هذين البلدين [1][1] انظر الجمعية الوطنية الفرنسية. لجنة....2أنها تحديداً من هذه التقييمات الجارية على أن الطريقة المثلى لتنظيم الخدمات الدبلوماسية في القرن العشرين أن المؤرخين يمكن إلقاء بعض الضوء على الطريقة التي اتخذت الحكومات في الاعتبار، فضلا عن الأبعاد الجديدة المفروضة في "الشؤون الدولية" على كيفية الرد من الناحية العملية داخل الحكومة. حيث يقدم فكرة هذا مسألة مجلتنا على أدوات جديدة للدبلوماسية في القرن العشرين.3ومن المؤكد أن مؤرخين علاقات الدولية كثير استثمرنا في تحليل الجوانب آخر مختلف الهوية التي تسمح لهم بفهم التغييرات الهامة التي ظهرت في المجتمعات المعاصرة، والانتباه إلى عملية طويلة تعرف باسم التدويل، ثم في الآونة الأخيرة، العولمة. باستعراض جداول المحتويات من 120 قضايا العلاقات الدولية اليومية، نشرت منذ عام 1974، يمكن مشاهدة مجموعة متنوعة المواضيع؛ يخصص جزءا كبيرا من هذه الورقات المنشورة آخذا في الاعتبار هذه "القوى العميقة" التي تعمل في قلب العلاقات الدولية، وفقا للصيغة التي وضعتها رينوفين Pierre وجان-باتيست دوروسيلي [2][2] في مقدمة التاريخ الكلاسيكي الآن.... Quant aux pratiques diplomatiques elles-mêmes, qui traduisent ou accompagnent les transformations des conditions politiques, économiques et sociales dont le monde contemporain est le théâtre, sans oublier les révolutions dans les techniques de communication entre les hommes, elles méritent elles aussi d’être analysées. Cela n’a pas échappé aux animateurs de notre revue, puisqu’elle a publié plusieurs contributions sur « les formes nouvelles de la diplomatie au XXe siècle » (nos 31 et 32) ; c’était il y a plus de vingt ans ! D’autres études ont été publiées sur certaines activités spécifiques qui se sont introduites progressivement dans la pratique diplomatique ; chacune des innovations organisationnelles a suscité des débats souvent intenses entre « généralistes » et « spécialistes » qu’il s’agit d’intégrer dans la mise en œuvre de la politique extérieure et notamment dans les lieux hautement symboliques que sont les postes diplomatiques à l’étranger.4Ainsi, la création des fonctions d’attaché militaire, commercial, financier ou culturel a fait l’objet de recherches spécifiques ou a été abordée de façon indirecte dans des études plus vastes ; l’apparition plus récente d’attachés sociaux, scientifiques et humanitaires mériterait elle aussi d’être prise en compte. Mais, par-delà l’étude de ces nouvelles fonctions de diplomatie sectorielle, il y a encore beaucoup à faire pour démontrer les interactions entre les « dossiers » gérés par les différentes administrations concernées ainsi qu’entre ces administrations elles-mêmes, dans la formulation ou la conduite des affaires extérieures des États. À cet égard, la consultation des collections de documents diplomatiques publiés fournit des indications précieuses sur cette extension du champ d’action des diplomaties des États et sur les solutions apportées à l’intégration des nouveaux secteurs d’activités diplomatiques dans la politique extérieure globale des gouvernements.5De toute évidence, les innovations sur le plan administratif apparaissent en fonction des besoins dûment reconnus par les gouvernements, mais elles ne comportent pas nécessairement la réciprocité dans les pratiques diplomatiques qui caractérise en général la représentation diplomatique sur le plan protocolaire. En effet, la grande majorité des États ne dispose pas de ressources suffisantes pour étoffer chacun de leurs postes diplomatiques par l’engagement d’autant d’agents que de fonctions identifiées. Par ailleurs, l’apparition des organisations internationales, qu’elles soient régionales ou universelles, politiques ou techniques, a contraint aussi la plupart des États à accorder des ressources croissantes à la conduite de la diplomatie multilatérale, phénomène qui a été analysé et systématisé dans les nos 39 et 40 de notre revue en 1984, notamment avec les contributions de Jean-Baptiste Duroselle et Jacques Freymond, fondateurs de la revue.6Or, ce qui était identifié à l’époque comme un fait relativement nouveau de la pratique diplomatique a connu des développements impressionnants depuis lors, sans que pour autant les relations bilatérales se soient amenuisées. Bien au contraire, la médiation de l’État dans les activités humaines n’a cessé de prendre de l’importance, au point qu’il devient de plus en plus difficile de dresser une limite dans quelque secteur que ce soit entre la politique intérieure et la politique extérieure dans nos sociétés de plus en plus interpénétrées et interactives sur le plan des échanges et des communications. On peut ainsi constater que la plupart des politiques dites « sectorielles » connaissent des prolongements internationaux et inversement, que ce soit sous l’angle multilatéral ou bilatéral. Pour la conduite des relations extérieures, cela entraîne des conséquences significatives, en ce sens que le gouvernement doit recourir de plus en plus à des agents qui proviennent des divers secteurs spécialisés de l’administration. Autrement dit, les diplomates ne sont plus les intermédiaires uniques et privilégiés entre les États.7Si, en effet, pendant longtemps les diplomates, représentant leurs États respectifs, ont eu le monopole dans l’exercice de la diplomatie, ils ont dû progressivement partager une partie substantielle de la défense des intérêts de leurs pays avec d’autres agents qui ne satisfont pas nécessairement aux mêmes impératifs de la vie internationale, ni aux mêmes pratiques. Par ailleurs, de nouveaux réseaux de compétences et d’intérêts se sont mis en place. D’autres acteurs que les États, notamment les organisations internationales, ont pris une place croissante dans les affaires mondiales [3][3] Cf. nos 75 et 76 de Relations internationales sur... ; enfin, d’autres instances qui jouissent de statuts particuliers comme le Saint-Siège ou le Comité international de la Croix-Rouge représentent une pratique originale tant sur le plan de la forme que des aspects dont elles s’occupent ; il conviendrait aussi d’y ajouter la myriade d’associations, notamment les ONG dont l’influence est parfois redoutable pour les États, selon les intérêts et les enjeux qu’elles représentent.8Au regard de la complexité des questions et des solutions qu’implique l’intégration de nouveaux outils dans la conduite de la politique extérieure, nous sommes bien conscients que l’ambition affichée ici est sans doute trop élevée, puisque nous ne pouvons publier que six contributions ; mais notre objectif serait déjà correctement honoré si nous réussissions à suggérer l’importance du travail de recherche à faire dans le domaine des pratiques diplomatiques par rapport à une société contemporaine engagée dans un processus accéléré de transformation à l’échelle mondiale. Les contributions proposées ouvrent, chacune sur un aspect particulier, une dimension nouvelle de pratiques et d’enjeux diplomatiques ; elles indiquent autant de chantiers de recherche qui s’offrent aux historiens des relations internationales, avant qu’ils ne puissent proposer une éventuelle pondération de l’influence sur la formulation de la politique extérieure des divers « secteurs » qui contribuent à tisser la grande toile de l’action diplomatique.9On retiendra par ailleurs que même les pratiques de la diplomatie dans sa forme la plus traditionnelle évoluent : il est clair que la partie représentative, pour ne pas dire mondaine, de la diplomatie a considérablement reculé par rapport aux fonctions plus modernes : on n’imagine plus une ambassade de quelque importance sans un diplomate spécialisé dans les rapports avec la presse, et tous les diplomates sont impliqués dans les questions économiques, pas seulement les attachés spécialisés. D’autre part, les moyens modernes de communication ont contribué à révolutionner l’activité diplomatique, par rapport à l’époque, pas si lointaine, des télégrammes péniblement chiffrés et déchiffrés à la main : la télécopie (chiffrée !), l’ordinateur et l’Internet font désormais partie des outils de travail du diplomate, modifient les conditions de son activité, modifieront aussi les méthodes de travail des futurs historiens [4][4] Pour un exemple des années 1950 : Georges-Henri Soutou,....10Dans leur contribution respective, les six auteurs abordent chacun des dimensions ou des aspects très différents les uns par rapport aux autres. Ainsi, la diplomatie économique multilatérale est abordée par Stanislas Jeannesson, qui illustre son propos en analysant plus particulièrement le rôle d’un des grands artisans français de l’action économique sur le plan international
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


يدخل
1 في البيئة الجديدة في العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة، التسارع و تكنولوجيا الاتصالاتالحكومات والبرلمانات، المزيد والمزيد من البلدان قيد النظر قد يأخذ شكل إعادة هيكلة أو إعادة نشر في الخارج باسم "و" الخدمات في إدارة السياسة الخارجية.وخاصة، يمكن أن أفضل حماية وتعزيز مصالح البلدوخاصة طرح القدرة على الابتكار، دون التضحية واجب حماية المواطنين أو المقيمين في الخارج بسبب الأصول.التحدي هو لا رقيقة، إذا كنت تقصد الحكومة على النظر في التنمية، مثل فرنسا وسويسرا، ولكن هذين pays [1]، [1] انظرالجمعية الوطنية الفرنسية.اللجنة..............
2.هذه هو تقييم من أفضل المنظمات في وزارة الخارجية في القرن العشرين المؤرخين يمكن جلب بعض الأفكار الجديدة، تنظر الحكومة في الحد من حجم في الشؤون الدولية، بشأن كيفية التصدي على المستوى العملي - الثديالوكالات الحكومية.
1 في البيئة الجديدة في العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة، التسارع و تكنولوجيا الاتصالاتالحكومات والبرلمانات، المزيد والمزيد من البلدان قيد النظر قد يأخذ شكل إعادة هيكلة أو إعادة نشر في الخارج باسم "و" الخدمات في إدارة السياسة الخارجية.وخاصة، يمكن أن أفضل حماية وتعزيز مصالح البلدوخاصة طرح القدرة على الابتكار، دون التضحية واجب حماية المواطنين أو المقيمين في الخارج بسبب الأصول.التحدي هو لا رقيقة، إذا كنت تقصد الحكومة على النظر في التنمية، مثل فرنسا وسويسرا، ولكن هذين pays [1]، [1] انظرالجمعية الوطنية الفرنسية.اللجنة..............
2.هذه هو تقييم من أفضل المنظمات في وزارة الخارجية في القرن العشرين المؤرخين يمكن جلب بعض الأفكار الجديدة، تنظر الحكومة في الحد من حجم في الشؤون الدولية، بشأن كيفية التصدي على المستوى العملي - الثديالوكالات الحكومية.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.
- while others are leapers
- احلام سعيدهتصبح على خير
- صديقي لؤي يحبك جدا سيدتي
- العمر كله
- Data Centre Co-Location Servicedata cent
- תינבע
- Data Centre Co-Location Servicedata cent
- תינבע
- كلمت صديق لي في وزارة العمل وقال لي هذه
- haha bad boy! let me put on my computer
- كلمت صديق لي في وزارة العمل وقال لي هذه
- il n'y a point de plus cruelle tyrannie
- تعرفي تتكلمي سوحليه ولا لا
- I miss you my loveYou lose me, my eyes w
- ماذا تفعل الأن
- هل ممكن ان ارى صورتك
- I miss you my loveYou lose me, my eyes w
- Component
- Male
- heyy, thx for adding me...i had your use
- نعم انها جميلة في الصورة وروحها جميلة ول
- انت في اي صف
- Knitter
- احلام سعيدهتصبح على خير