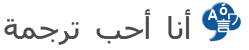- النص
- تاريخ
Diplomaties économiques d’entrepris
Diplomaties économiques d’entreprises et ONG
42
La diplomatie économique des entreprises doit intégrer la croissance fulgurante des réseaux sociaux en ligne et, au-delà, des mouvements fédérateurs d’idées, d’opinions et de causes.
43
En octobre 2007, le New York Times s’étonnait des 1 000 abonnés du site de « micro-blogging » Twitter. Trois ans plus tard, ce sont 175 millions de personnes qui y sont inscrits. Au printemps 2009, dans une course symbolique, l’acteur Ashton Kushter a défié CNN – et gagné – dans le concours au premier million de followers sur Twitter. De son côté, Facebook a dépassé les 500 millions d’abonnés six ans seulement après avoir été lancé sur le campus de Harvard.
44
Les réputations se font et se défont de plus en plus sur la toile d’Internet. Les sociétés commencent seulement à prendre la mesure des changements tectoniques en cours.
45
La bataille entre Nestlé et Greenpeace début 2010 a révélé l’écho potentiellement pris par des messages diffusés via les réseaux sociaux. L’ONG dénonçait l’usage d’huile de palme par Kitkat (marque du groupe suisse) contribuant selon elle à la déforestation en Indonésie. Elle a lancé un blitzkrieg cyberspatial fulgurant avec des « kits de campagne » incluant des vidéos détournées permettant une propagation virale de sa position sur – entre autres – les sites de Facebook, Twitter, YouTube et e-cards. La réponse de Nestlé mi-mars 2010 est restée peu connue. La réaction à sa décision de faire retirer la vidéo de YouTube et à ses injonctions aux internautes de ne plus la propager a été catastrophique. L’image de Nestlé sur la toile a souffert et son cours de bourse a chuté, même si ce n’est que temporairement.
46
Les enseignements sont multiples. Dans un monde en réseau les entreprises ne peuvent plus ignorer la « troisième dimension » des communautés d’opinion. Leur nombre, celui de leurs adhérents, mais plus encore la fulgurance de la circulation de leurs idées, en font des acteurs incontournables de la société. Par ailleurs, les formes contraignantes de résolution de conflit ont peu de prise quand il suffit d’un serveur pour propager à nouveau une opinion. Enfin, la présence sur la toile ne suffit pas (lors de la passe d’armes avec Greenpeace, Nestlé comptait 90 000 fans sur sa page Facebook). Le ton adopté doit correspondre au média utilisé (l’injonction étant en l’occurrence contre-productive).
47
Paradoxe de taille dans une société post-industrielle : un des facteurs clés d’influence des consommateurs devient le « bouche-à-oreille mondial » sur Internet. D’après l’agence Fullsix 78 % d’entre eux font plus confiance à des amis qu’à de la publicité.
48
La diplomatie des entreprises vers les communautés est bien plus exigeante qu’une campagne mondiale de publicité autour d’un simple slogan. Elle suppose une parfaite cohérence entre un message, voire une narration, et les multiples groupes à qui elles s’adressent. Ce faisant les sociétés se doivent de garder une forte cohésion par rapport à la direction globale de l’entreprise.
49
Cette nouvelle diplomatie dématérialisée a déjà une importance stratégique. Elle sera vraisemblablement centrale dans quelques années.
Diplomatie économique des entreprises françaises
50
La place de PME et de groupes français dans l’intensification des politiques de coopération bilatérales au sein de partenariats stratégiques a une dimension essentielle. La France dispose d’un réseau diplomatique exceptionnel et a historiquement été parmi les plus importants contributeurs aux programmes de développement internationaux. De nombreuses sociétés françaises disposent d’experts mondialement reconnus qui peuvent contribuer à une coopération avec les grands États émergents et pays en voie de développement dans des domaines tels que l’environnement, la santé, l’urbanisme et la mise en place de grandes infrastructures ou la sécurité sociale. La France rentrerait ainsi dans un véritable partenariat avec ces États sur des sujets qui les préoccupent. Ce positionnement aurait un triple bénéfice pour la France : influence décuplée, positionnement de pointe sur les marchés d’expertise (100 milliards d’euros annuels estimés) et avantage concurrentiel sur les marchés induits.
51
Une coordination interministérielle favorisant le dialogue d’entités publiques et privées françaises avec des pays partenaires aurait un effet d’accélérateur sur les initiatives françaises dans ces États. Les partenariats et leur pilotage sont des catalyseurs puissants de fédération des actions en direction des pays partenaires et, au-delà, vers la communauté internationale. Ils peuvent devenir le ferment d’une véritable synchronisation des diplomaties économiques publique et privée françaises.
52
La création, approuvée en juillet 2010 par l’assemblée, d’un opérateur pour l’expertise et la mobilité internationales va sans nul doute donner un élan puissant à la France dans son positionnement sur les grands marchés publics internationaux d’expertise.
53
Par ailleurs, la fusion de CampusFrance, d’Egide et de France coopération internationale devrait apporter des effets de levier quasi-immédiats sur l’action de ces institutions. Au-delà des cadres juridiques et des transferts de compétences, une synchronisation accrue est essentielle entre les différents acteurs de l’« équipe de France » économique.
54
Les directives récentes du ministère de l’Économie et des Finances et du secrétariat d’État au commerce extérieur encouragent également une plus grande coordination, dans le domaine économique, entre les actions visant à faire croître les flux sortants (commerce extérieur – via notamment Ubifrance, OSEO, la COFACE, les CCE et les CCI) et les flux entrants d’IDE (AFII), le tout de concert avec les actions menées par des sociétés et des groupes dynamiques dans leur politique de diplomatie économique. Des actions concertées telles que la coordination (dates de lancement, fournisseurs, messages clés et leurs déclinaisons dans les pays) des campagnes mondiales de publicité de la « France qui exporte » (les produits et les services) et la « France qui accueille » (les touristes, les talents et les investissements) peuvent avoir un impact majeur et rapide.
55
Ces partenariats transverses entre établissements publics et privés sont déterminants pour une plus grande efficacité des dispositifs. La diplomatie économique des opérateurs privés français s’en verra facilitée d’autant car s’inscrivant dans un cadre clair avec un message structuré porté par l’ensemble des acteurs.
56
La coordination des diplomaties économiques publique et privée donnerait des atouts considérables à la France. Son capital de sympathie à l’international est ainsi sous-utilisé dans les grands pays émergents, moteurs de la croissance mondiale dans les décennies à venir (leur contribution à la progression du PIB mondial est estimée à près de 60 % en 2014). La France pourrait rentrer dans un partenariat gagnant-gagnant avec des États qui n’ont pour l’heure que des relations réduites avec la plupart des pays de l’Union européenne.
57
Cette initiative doit être conjuguée à la projection internationale d’une « marque France » et à la synchronisation de la diplomatie économique de l’État avec celle des sociétés françaises se positionnant à l’international.
De nouvelles diplomaties demain
58
Les dernières décennies ont vu des bouleversements extraordinaires dans les relations entre entreprises, États et mouvements d’opinions. Ces changements vont probablement encore s’amplifier, transformant en profondeur les formes de diplomatie.
59
On assiste d’une part à l’accélération de trajectoires croisées entre acteurs publics et privés. Les pays se préoccupent de manière croissante de contestations internes (revendications catégorielles, développement du communautarisme, parfois poussées séparatistes) tandis que les entreprises rencontrent des tensions inédites sur le grand échiquier planétaire. Initialement confinées dans un espace limité, elles interagissent mondialement avec des formes de pouvoir traditionnelles (étatiques) et nouvelles (communautés virtuelles et ONG) dans des alliances compétitives qu’elles maîtrisent encore mal. Les États cherchent par ailleurs à vanter leur valeur ajoutée économique tandis que les grands groupes privés se veulent force de proposition dans le nouvel ordre mondial. Dans cette dynamique inversée entre acteurs privés et publics, chacun emprunte à l’autre des techniques éprouvées. Des pays (Chine, Canada, Afrique du Sud, Inde) et régions (Catalogne, Lombardie, Floride) adoptent des stratégies de marque traditionnellement réservées au secteur privé. Concurremment, la boîte à outil diplomatique devient un nouveau recours stratégique pour les entreprises.
60
Par ailleurs, l’évolution des rapports de force entre les trois dimensions publique, privée et communautaire va susciter de nouvelles formes d’interaction. Les entreprises et, plus encore, les associations se concentrent rapidement, ce qui les renforce – à l’inverse des États. Toutefois les pays compensent leur faiblesse relative par une meilleure propension aux coalitions. Dans le jeu politique mondial, on voit se former des partenariats régionaux ou multilatéraux (EU, OCS, ASEAN, Mercosur, APEC, OUA, etc.) mais aussi des regroupements de plus en plus nombreux lors d’événements ponctuels tels que le G77 à Copenhague en décembre 2009. Se développe enfin un embryon de gouvernance mondiale étatique avec la maturation progressive du G20.
61
Les entreprises sont quant à elles limitées par les règles de concurrence dans le périmètre de leurs consortia. Les mouvements d’opinion, communautés virtuelles et ONG ont encore du mal à se coaliser. La perte de vitesse du Forum social mondial après des débuts retentissants à Porto Alegre en est une illustration.
62
La fédération, même éphémère, des États autour de causes et d’intérêts communs, leur permet jusqu’ici de maintenir u
42
La diplomatie économique des entreprises doit intégrer la croissance fulgurante des réseaux sociaux en ligne et, au-delà, des mouvements fédérateurs d’idées, d’opinions et de causes.
43
En octobre 2007, le New York Times s’étonnait des 1 000 abonnés du site de « micro-blogging » Twitter. Trois ans plus tard, ce sont 175 millions de personnes qui y sont inscrits. Au printemps 2009, dans une course symbolique, l’acteur Ashton Kushter a défié CNN – et gagné – dans le concours au premier million de followers sur Twitter. De son côté, Facebook a dépassé les 500 millions d’abonnés six ans seulement après avoir été lancé sur le campus de Harvard.
44
Les réputations se font et se défont de plus en plus sur la toile d’Internet. Les sociétés commencent seulement à prendre la mesure des changements tectoniques en cours.
45
La bataille entre Nestlé et Greenpeace début 2010 a révélé l’écho potentiellement pris par des messages diffusés via les réseaux sociaux. L’ONG dénonçait l’usage d’huile de palme par Kitkat (marque du groupe suisse) contribuant selon elle à la déforestation en Indonésie. Elle a lancé un blitzkrieg cyberspatial fulgurant avec des « kits de campagne » incluant des vidéos détournées permettant une propagation virale de sa position sur – entre autres – les sites de Facebook, Twitter, YouTube et e-cards. La réponse de Nestlé mi-mars 2010 est restée peu connue. La réaction à sa décision de faire retirer la vidéo de YouTube et à ses injonctions aux internautes de ne plus la propager a été catastrophique. L’image de Nestlé sur la toile a souffert et son cours de bourse a chuté, même si ce n’est que temporairement.
46
Les enseignements sont multiples. Dans un monde en réseau les entreprises ne peuvent plus ignorer la « troisième dimension » des communautés d’opinion. Leur nombre, celui de leurs adhérents, mais plus encore la fulgurance de la circulation de leurs idées, en font des acteurs incontournables de la société. Par ailleurs, les formes contraignantes de résolution de conflit ont peu de prise quand il suffit d’un serveur pour propager à nouveau une opinion. Enfin, la présence sur la toile ne suffit pas (lors de la passe d’armes avec Greenpeace, Nestlé comptait 90 000 fans sur sa page Facebook). Le ton adopté doit correspondre au média utilisé (l’injonction étant en l’occurrence contre-productive).
47
Paradoxe de taille dans une société post-industrielle : un des facteurs clés d’influence des consommateurs devient le « bouche-à-oreille mondial » sur Internet. D’après l’agence Fullsix 78 % d’entre eux font plus confiance à des amis qu’à de la publicité.
48
La diplomatie des entreprises vers les communautés est bien plus exigeante qu’une campagne mondiale de publicité autour d’un simple slogan. Elle suppose une parfaite cohérence entre un message, voire une narration, et les multiples groupes à qui elles s’adressent. Ce faisant les sociétés se doivent de garder une forte cohésion par rapport à la direction globale de l’entreprise.
49
Cette nouvelle diplomatie dématérialisée a déjà une importance stratégique. Elle sera vraisemblablement centrale dans quelques années.
Diplomatie économique des entreprises françaises
50
La place de PME et de groupes français dans l’intensification des politiques de coopération bilatérales au sein de partenariats stratégiques a une dimension essentielle. La France dispose d’un réseau diplomatique exceptionnel et a historiquement été parmi les plus importants contributeurs aux programmes de développement internationaux. De nombreuses sociétés françaises disposent d’experts mondialement reconnus qui peuvent contribuer à une coopération avec les grands États émergents et pays en voie de développement dans des domaines tels que l’environnement, la santé, l’urbanisme et la mise en place de grandes infrastructures ou la sécurité sociale. La France rentrerait ainsi dans un véritable partenariat avec ces États sur des sujets qui les préoccupent. Ce positionnement aurait un triple bénéfice pour la France : influence décuplée, positionnement de pointe sur les marchés d’expertise (100 milliards d’euros annuels estimés) et avantage concurrentiel sur les marchés induits.
51
Une coordination interministérielle favorisant le dialogue d’entités publiques et privées françaises avec des pays partenaires aurait un effet d’accélérateur sur les initiatives françaises dans ces États. Les partenariats et leur pilotage sont des catalyseurs puissants de fédération des actions en direction des pays partenaires et, au-delà, vers la communauté internationale. Ils peuvent devenir le ferment d’une véritable synchronisation des diplomaties économiques publique et privée françaises.
52
La création, approuvée en juillet 2010 par l’assemblée, d’un opérateur pour l’expertise et la mobilité internationales va sans nul doute donner un élan puissant à la France dans son positionnement sur les grands marchés publics internationaux d’expertise.
53
Par ailleurs, la fusion de CampusFrance, d’Egide et de France coopération internationale devrait apporter des effets de levier quasi-immédiats sur l’action de ces institutions. Au-delà des cadres juridiques et des transferts de compétences, une synchronisation accrue est essentielle entre les différents acteurs de l’« équipe de France » économique.
54
Les directives récentes du ministère de l’Économie et des Finances et du secrétariat d’État au commerce extérieur encouragent également une plus grande coordination, dans le domaine économique, entre les actions visant à faire croître les flux sortants (commerce extérieur – via notamment Ubifrance, OSEO, la COFACE, les CCE et les CCI) et les flux entrants d’IDE (AFII), le tout de concert avec les actions menées par des sociétés et des groupes dynamiques dans leur politique de diplomatie économique. Des actions concertées telles que la coordination (dates de lancement, fournisseurs, messages clés et leurs déclinaisons dans les pays) des campagnes mondiales de publicité de la « France qui exporte » (les produits et les services) et la « France qui accueille » (les touristes, les talents et les investissements) peuvent avoir un impact majeur et rapide.
55
Ces partenariats transverses entre établissements publics et privés sont déterminants pour une plus grande efficacité des dispositifs. La diplomatie économique des opérateurs privés français s’en verra facilitée d’autant car s’inscrivant dans un cadre clair avec un message structuré porté par l’ensemble des acteurs.
56
La coordination des diplomaties économiques publique et privée donnerait des atouts considérables à la France. Son capital de sympathie à l’international est ainsi sous-utilisé dans les grands pays émergents, moteurs de la croissance mondiale dans les décennies à venir (leur contribution à la progression du PIB mondial est estimée à près de 60 % en 2014). La France pourrait rentrer dans un partenariat gagnant-gagnant avec des États qui n’ont pour l’heure que des relations réduites avec la plupart des pays de l’Union européenne.
57
Cette initiative doit être conjuguée à la projection internationale d’une « marque France » et à la synchronisation de la diplomatie économique de l’État avec celle des sociétés françaises se positionnant à l’international.
De nouvelles diplomaties demain
58
Les dernières décennies ont vu des bouleversements extraordinaires dans les relations entre entreprises, États et mouvements d’opinions. Ces changements vont probablement encore s’amplifier, transformant en profondeur les formes de diplomatie.
59
On assiste d’une part à l’accélération de trajectoires croisées entre acteurs publics et privés. Les pays se préoccupent de manière croissante de contestations internes (revendications catégorielles, développement du communautarisme, parfois poussées séparatistes) tandis que les entreprises rencontrent des tensions inédites sur le grand échiquier planétaire. Initialement confinées dans un espace limité, elles interagissent mondialement avec des formes de pouvoir traditionnelles (étatiques) et nouvelles (communautés virtuelles et ONG) dans des alliances compétitives qu’elles maîtrisent encore mal. Les États cherchent par ailleurs à vanter leur valeur ajoutée économique tandis que les grands groupes privés se veulent force de proposition dans le nouvel ordre mondial. Dans cette dynamique inversée entre acteurs privés et publics, chacun emprunte à l’autre des techniques éprouvées. Des pays (Chine, Canada, Afrique du Sud, Inde) et régions (Catalogne, Lombardie, Floride) adoptent des stratégies de marque traditionnellement réservées au secteur privé. Concurremment, la boîte à outil diplomatique devient un nouveau recours stratégique pour les entreprises.
60
Par ailleurs, l’évolution des rapports de force entre les trois dimensions publique, privée et communautaire va susciter de nouvelles formes d’interaction. Les entreprises et, plus encore, les associations se concentrent rapidement, ce qui les renforce – à l’inverse des États. Toutefois les pays compensent leur faiblesse relative par une meilleure propension aux coalitions. Dans le jeu politique mondial, on voit se former des partenariats régionaux ou multilatéraux (EU, OCS, ASEAN, Mercosur, APEC, OUA, etc.) mais aussi des regroupements de plus en plus nombreux lors d’événements ponctuels tels que le G77 à Copenhague en décembre 2009. Se développe enfin un embryon de gouvernance mondiale étatique avec la maturation progressive du G20.
61
Les entreprises sont quant à elles limitées par les règles de concurrence dans le périmètre de leurs consortia. Les mouvements d’opinion, communautés virtuelles et ONG ont encore du mal à se coaliser. La perte de vitesse du Forum social mondial après des débuts retentissants à Porto Alegre en est une illustration.
62
La fédération, même éphémère, des États autour de causes et d’intérêts communs, leur permet jusqu’ici de maintenir u
0/5000
الدبلوماسية الاقتصادية للشركات والمنظمات 42 يجب دمج الدبلوماسية الاقتصادية للشركات أن النمو الهائل للإنترنت والشبكات الاجتماعية وما بعدة، حركة توحيد الأفكار والآراء والأسباب.43في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وقد دهش نيويورك تايمز من 1000 مشترك في موقع "المدونات الصغيرة" تويتر. بعد ثلاث سنوات، وهم 175 مليون شخص مسجلين. في ربيع عام 2009، في سباق رمزية، تحدي الممثل "أشتون كوشتير" سي-وفاز-في المسابقة في اتباع أولاً 1 مليون على تويتر. ومن ناحية أخرى، تجاوزت أمام المشتركين 500 مليون ست سنوات فقط بعد وقد تم الشروع في حرم جامعة هارفارد.44سمعتهم وكشف شبكة الإنترنت. والشركات فقط بداية لتقييم التغيرات التكتونية الجارية.45المعركة بين شركة نستله وغرين بيس مطلع 2010 كشفت صدى رسائل يحتمل أن تكون معتمدة توزع عن طريق الشبكات الاجتماعية. نددت المنظمات استخدام زيت النخيل كيتكات (العلامة التجارية للفريق السويسري) أنها تسهم في إزالة الغابات في إندونيسيا. بدأ هارب الفضاء الإلكتروني الحرب الخاطفة مع "مجموعات حملة" بما في ذلك أشرطة الفيديو تحويلها إلى انتشار فيروسي موقفها في--في جملة أمور-مواقع ألفيس بوك، تويتر، يوتيوب والبطاقات الإلكترونية. الرد من شركة نستله منتصف آذار/مارس 2010 ظلت غير معروفة جيدا. وكان رد الفعل على قراره بإزالة الفيديو من يوتيوب وأوامر نشر المستخدمين لم تعد كارثية. وقد عانت صورة نستله على لوحة الرسم القماشية وقد انخفضت أسعار أسهمها، حتى لو كان مؤقتاً فقط.46العديد من الدروس. في عالم شبكات التجارية لم يعد تجاهل 'البعد الثالث' للمجتمعات المحلية في الرأي. جعل عددهم، أحد أعضائها، ولكن الأهم من ذلك أوفيربووير لتداول الأفكار، والجهات الفاعلة في المجتمع. وعلاوة على ذلك، أشكال ملزمة لتسوية المنازعات قد صنع القرار قليلاً عند مجرد خادم لنشر رأي مرة أخرى. وأخيراً، وجود على شبكة الإنترنت لا يكفي (خلال المناوشات مع غرين بيس، كان نستله المشجعين 90 000 على صفحة فيسبوك له). يجب أن تطابق اعتمد لهجة وسائل الإعلام المستخدمة (الأمر الذي يؤدي إلى نتائج عكسية في هذه الحالة).47مفارقة للحجم في مجتمع ما بعد الصناعة: واحد من مفاتيح للتأثير على المستهلكين يصبح "العالم كلمة من فمه" على شبكة الإنترنت. وبعد "فولسيكس الوكالة" 78% منهم بمزيد من الثقة للأصدقاء فقط للدعاية.48الدبلوماسية للشركات تجاه المجتمعات التي أعلى بكثير من حملة عالمية للإعلان حول شعار. وهو يفترض تماسك مثالي بين رسالة، أو السرد، والعديد من المجموعات التي يتم تناولها. في القيام بذلك يجب أن تبقى الشركات التلاحم قوي إلى الاتجاه العام للشركة.49Cette nouvelle diplomatie dématérialisée a déjà une importance stratégique. Elle sera vraisemblablement centrale dans quelques années.Diplomatie économique des entreprises françaises 50La place de PME et de groupes français dans l’intensification des politiques de coopération bilatérales au sein de partenariats stratégiques a une dimension essentielle. La France dispose d’un réseau diplomatique exceptionnel et a historiquement été parmi les plus importants contributeurs aux programmes de développement internationaux. De nombreuses sociétés françaises disposent d’experts mondialement reconnus qui peuvent contribuer à une coopération avec les grands États émergents et pays en voie de développement dans des domaines tels que l’environnement, la santé, l’urbanisme et la mise en place de grandes infrastructures ou la sécurité sociale. La France rentrerait ainsi dans un véritable partenariat avec ces États sur des sujets qui les préoccupent. Ce positionnement aurait un triple bénéfice pour la France : influence décuplée, positionnement de pointe sur les marchés d’expertise (100 milliards d’euros annuels estimés) et avantage concurrentiel sur les marchés induits.51Une coordination interministérielle favorisant le dialogue d’entités publiques et privées françaises avec des pays partenaires aurait un effet d’accélérateur sur les initiatives françaises dans ces États. Les partenariats et leur pilotage sont des catalyseurs puissants de fédération des actions en direction des pays partenaires et, au-delà, vers la communauté internationale. Ils peuvent devenir le ferment d’une véritable synchronisation des diplomaties économiques publique et privée françaises.52La création, approuvée en juillet 2010 par l’assemblée, d’un opérateur pour l’expertise et la mobilité internationales va sans nul doute donner un élan puissant à la France dans son positionnement sur les grands marchés publics internationaux d’expertise.53Par ailleurs, la fusion de CampusFrance, d’Egide et de France coopération internationale devrait apporter des effets de levier quasi-immédiats sur l’action de ces institutions. Au-delà des cadres juridiques et des transferts de compétences, une synchronisation accrue est essentielle entre les différents acteurs de l’« équipe de France » économique.54Les directives récentes du ministère de l’Économie et des Finances et du secrétariat d’État au commerce extérieur encouragent également une plus grande coordination, dans le domaine économique, entre les actions visant à faire croître les flux sortants (commerce extérieur – via notamment Ubifrance, OSEO, la COFACE, les CCE et les CCI) et les flux entrants d’IDE (AFII), le tout de concert avec les actions menées par des sociétés et des groupes dynamiques dans leur politique de diplomatie économique. Des actions concertées telles que la coordination (dates de lancement, fournisseurs, messages clés et leurs déclinaisons dans les pays) des campagnes mondiales de publicité de la « France qui exporte » (les produits et les services) et la « France qui accueille » (les touristes, les talents et les investissements) peuvent avoir un impact majeur et rapide.55Ces partenariats transverses entre établissements publics et privés sont déterminants pour une plus grande efficacité des dispositifs. La diplomatie économique des opérateurs privés français s’en verra facilitée d’autant car s’inscrivant dans un cadre clair avec un message structuré porté par l’ensemble des acteurs.56La coordination des diplomaties économiques publique et privée donnerait des atouts considérables à la France. Son capital de sympathie à l’international est ainsi sous-utilisé dans les grands pays émergents, moteurs de la croissance mondiale dans les décennies à venir (leur contribution à la progression du PIB mondial est estimée à près de 60 % en 2014). La France pourrait rentrer dans un partenariat gagnant-gagnant avec des États qui n’ont pour l’heure que des relations réduites avec la plupart des pays de l’Union européenne.57Cette initiative doit être conjuguée à la projection internationale d’une « marque France » et à la synchronisation de la diplomatie économique de l’État avec celle des sociétés françaises se positionnant à l’international.De nouvelles diplomaties demain 58Les dernières décennies ont vu des bouleversements extraordinaires dans les relations entre entreprises, États et mouvements d’opinions. Ces changements vont probablement encore s’amplifier, transformant en profondeur les formes de diplomatie.59On assiste d’une part à l’accélération de trajectoires croisées entre acteurs publics et privés. Les pays se préoccupent de manière croissante de contestations internes (revendications catégorielles, développement du communautarisme, parfois poussées séparatistes) tandis que les entreprises rencontrent des tensions inédites sur le grand échiquier planétaire. Initialement confinées dans un espace limité, elles interagissent mondialement avec des formes de pouvoir traditionnelles (étatiques) et nouvelles (communautés virtuelles et ONG) dans des alliances compétitives qu’elles maîtrisent encore mal. Les États cherchent par ailleurs à vanter leur valeur ajoutée économique tandis que les grands groupes privés se veulent force de proposition dans le nouvel ordre mondial. Dans cette dynamique inversée entre acteurs privés et publics, chacun emprunte à l’autre des techniques éprouvées. Des pays (Chine, Canada, Afrique du Sud, Inde) et régions (Catalogne, Lombardie, Floride) adoptent des stratégies de marque traditionnellement réservées au secteur privé. Concurremment, la boîte à outil diplomatique devient un nouveau recours stratégique pour les entreprises.60Par ailleurs, l’évolution des rapports de force entre les trois dimensions publique, privée et communautaire va susciter de nouvelles formes d’interaction. Les entreprises et, plus encore, les associations se concentrent rapidement, ce qui les renforce – à l’inverse des États. Toutefois les pays compensent leur faiblesse relative par une meilleure propension aux coalitions. Dans le jeu politique mondial, on voit se former des partenariats régionaux ou multilatéraux (EU, OCS, ASEAN, Mercosur, APEC, OUA, etc.) mais aussi des regroupements de plus en plus nombreux lors d’événements ponctuels tels que le G77 à Copenhague en décembre 2009. Se développe enfin un embryon de gouvernance mondiale étatique avec la maturation progressive du G20.61Les entreprises sont quant à elles limitées par les règles de concurrence dans le périmètre de leurs consortia. Les mouvements d’opinion, communautés virtuelles et ONG ont encore du mal à se coaliser. La perte de vitesse du Forum social mondial après des débuts retentissants à Porto Alegre en est une illustration.62La fédération, même éphémère, des États autour de causes et d’intérêts communs, leur permet jusqu’ici de maintenir u
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


الشركات والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الاقتصادية 42
، يجب أن الشركات السريعة النمو في الشبكات الاجتماعية على الانترنت، بالإضافة إلى ذلك، العمود الفقري حركة الأفكار و السبب.......
43، تشرين الأول / أكتوبر مفاجأة نيويورك تايمز 1 مليون مستخدم "مصغرة موقع المدونات الصغيرة تويتر".بعد ثلاث سنوات،هذا هو 175 مليون شخص مسجلة.في ربيع عام 2009، في معركة رمزية، الممثل أشتون kushter التحديات – سي ان ان و الفوز في 10 آلاف من أتباع التغريد.بدوره، من مستخدمي الفيسبوك أكثر من 5 مليون بعد 6 سنوات بدأت في حرم جامعة هارفارد 44.......
، يجب أن الشركات السريعة النمو في الشبكات الاجتماعية على الانترنت، بالإضافة إلى ذلك، العمود الفقري حركة الأفكار و السبب.......
43، تشرين الأول / أكتوبر مفاجأة نيويورك تايمز 1 مليون مستخدم "مصغرة موقع المدونات الصغيرة تويتر".بعد ثلاث سنوات،هذا هو 175 مليون شخص مسجلة.في ربيع عام 2009، في معركة رمزية، الممثل أشتون kushter التحديات – سي ان ان و الفوز في 10 آلاف من أتباع التغريد.بدوره، من مستخدمي الفيسبوك أكثر من 5 مليون بعد 6 سنوات بدأت في حرم جامعة هارفارد 44.......
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.
- على الشركات الافصاح الكافي عن المعلومات
- nversion centerinversion: every point x,
- هل تحبين الجنس
- على الشركات الافصاح الكافي عن المعلومات
- nversion centerinversion: every point x,
- ارتاحي ٢ ساعه ثم اشتغلي
- هل تحبين الجنس
- sll ttebeD t
- those who back scenery has spread harbor
- Why did you add me?
- اريد ان ارى
- Account not ln this store
- انا احب مدرستي
- اين جاءت هاده المدينة
- اين ابنك
- من اي دولة يا عزيزتي
- لاشي، فقط اريد ان اكون صديقك
- se trouver
- اه كنت مخطوبة بس محصلش نصيب
- Everything for you is okay
- اه كنت مخطوبة بس محصلش نصيب
- ازخودت است جام
- نعم احبك وكم تمنيت ان اقبل شفتيكي
- اوكيه اجمل واحلي امراه في التاريخ