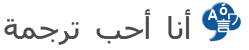- النص
- تاريخ
Un cadre conceptuel complexe pour d
Un cadre conceptuel complexe pour des menaces intriquées
9
L’homme, placé au cœur du problème, est ici considéré comme essentiel pour la sécurité internationale où l’ordre dépend in fine de la sécurité de chacun. Dans cette perspective, le statut de l’individu passe de celui de simple citoyen d’un État à celui d’un acteur impliqué dans les relations internationales. De fait, on assimile la force du système international à celle de son chaînon le plus faible – l’homme –, et lorsque la sécurité de l’individu est menacée, la sécurité internationale l’est aussi.
10
L’accent est donc mis sur l’individu au sein de l’État plutôt que sur la structure « État » elle-même.
11
C’est à partir de la moitié du XXe siècle que des menaces protéiformes ont exigé de repenser les notions traditionnelles de sécurité calées uniquement et historiquement sur les agressions militaires extérieures. Des menaces aux vitesses de diffusion terrifiantes dans des dimensions transnationales non circonscrites qui font du cadre analytique proposé par la sécurité humaine un socle de réponses à leur complexité.
12
Ainsi, la sécurité humaine est requise en tant qu’approche intégrale, utilisant une large gamme de nouvelles possibilités pour aborder les menaces de façon intégrée. Ces dernières demandent un nouveau consensus qui reconnaît les liens entre le développement, les différents droits de la personne – civiques, politiques, économiques, sociaux, culturels – et la sécurité nationale.
13
Car les menaces primaires sont d’abord internes et se manifestent dans des conditions d’échec économique, de violation des droits fondamentaux et de marginalisation politique. Par conséquent, le garant de la sécurité nationale n’est pas la puissance militaire mais un ensemble de conditions sociales, politiques et économiques favorables associé à la promotion de politiques inclusives.
14
L’approche par la sécurité humaine permet de reconnaître des menaces largement diversifiées et de se concentrer sur l’expérience quotidienne de l’insécurité qui inclut la non-satisfaction de besoins fondamentaux tels que la nourriture, la santé, l’emploi, le logement et l’écologie.
15
Avant d’aller plus loin, il faut pouvoir concevoir l’homme comme détenteur du pouvoir suprême et comme objet principal de toutes les attentions. Partant de là, on replace les institutions de gouvernance dans le champ des moyens toujours perfectibles.
16
La survie, le bien-être et la dignité de l’individu sont donc l’ultime objectif. Les constructions telles que l’État, la démocratie et le marché occupent dès lors une place secondaire en tant qu’outils.
17
Les menaces visant les États, les marchés et la démocratie sont autant de vulnérabilités parce qu’en fin de compte elles affectent « l’outil de production » du bien-être, des capacités, des opportunités et des libertés de l’individu.
18
Par essence, la sécurité humaine se définit comme un concept interdisciplinaire qui comporte les principales caractéristiques suivantes :
• centrée sur la personne, intégratrice et participative ;
• multisectorielle ;
• holistique ;
• spécifique au contexte ;
• orientée vers la prévention.
La sécurité humaine souligne l’interdépendance entre les différentes menaces qui se nourrissent les unes des autres et elle identifie un seuil audessous duquel la vie humaine est menacée. De fait, ses approches combinées mettent l’accent sur le besoin de réponses coopératives et multisectorielles, basées sur la mise en commun des agendas des acteurs de la sécurité, du développement et des droits de la personne.
19
Des solutions contextualisées sont donc avancées en réponse aux situations spécifiques, tout en introduisant une approche double de protection et d’autonomisation.
20
La protection implique une approche descendante – top down. Les États sont les premiers responsables de la mise en œuvre de cette structure protectrice. Alors que l’autonomisation implique une approche ascendante – down top. Elle vise à développer l’aptitude des individus et des collectivités à faire des choix éclairés et à agir en leur nom propre. Ici, protection et autonomisation se renforcent mutuellement.
21
Par ce cadre normatif, la sécurité humaine, pour laquelle les instruments de l’État devraient œuvrer efficacement et équitablement, devient tant au niveau national qu’international un bien public mondial que les États et la communauté internationale devraient se fixer comme objectif de préservation. L’efficacité d’un État ne peut être estimée que dans la mesure où il est capable d’atteindre cet objectif final.
22
À l’objectif de « croissance avec équité » du développement humain, la sécurité humaine ajoute la dimension importante de « récession avec sécurité ». En effet, la sécurité humaine reconnaît que les individus sont confrontés à des insécurités par privations soudaines suite aux récessions liées aux conflits, aux crises économiques et financières, aux maladies et catastrophes naturelles. Ces événements effacent des années de développement mais créent aussi des conditions sociales dans lesquelles les griefs peuvent donner lieu à des tensions croissantes.
23
Outre l’accent mis sur le bien-être humain, la sécurité humaine est guidée par des valeurs liées à la stabilité et la durabilité des gains de développement. Ainsi, la sécurité humaine met en évidence l’universalité et la primauté d’une série de droits et de libertés qui s’avèrent essentiels à une vie en société durable.
9
L’homme, placé au cœur du problème, est ici considéré comme essentiel pour la sécurité internationale où l’ordre dépend in fine de la sécurité de chacun. Dans cette perspective, le statut de l’individu passe de celui de simple citoyen d’un État à celui d’un acteur impliqué dans les relations internationales. De fait, on assimile la force du système international à celle de son chaînon le plus faible – l’homme –, et lorsque la sécurité de l’individu est menacée, la sécurité internationale l’est aussi.
10
L’accent est donc mis sur l’individu au sein de l’État plutôt que sur la structure « État » elle-même.
11
C’est à partir de la moitié du XXe siècle que des menaces protéiformes ont exigé de repenser les notions traditionnelles de sécurité calées uniquement et historiquement sur les agressions militaires extérieures. Des menaces aux vitesses de diffusion terrifiantes dans des dimensions transnationales non circonscrites qui font du cadre analytique proposé par la sécurité humaine un socle de réponses à leur complexité.
12
Ainsi, la sécurité humaine est requise en tant qu’approche intégrale, utilisant une large gamme de nouvelles possibilités pour aborder les menaces de façon intégrée. Ces dernières demandent un nouveau consensus qui reconnaît les liens entre le développement, les différents droits de la personne – civiques, politiques, économiques, sociaux, culturels – et la sécurité nationale.
13
Car les menaces primaires sont d’abord internes et se manifestent dans des conditions d’échec économique, de violation des droits fondamentaux et de marginalisation politique. Par conséquent, le garant de la sécurité nationale n’est pas la puissance militaire mais un ensemble de conditions sociales, politiques et économiques favorables associé à la promotion de politiques inclusives.
14
L’approche par la sécurité humaine permet de reconnaître des menaces largement diversifiées et de se concentrer sur l’expérience quotidienne de l’insécurité qui inclut la non-satisfaction de besoins fondamentaux tels que la nourriture, la santé, l’emploi, le logement et l’écologie.
15
Avant d’aller plus loin, il faut pouvoir concevoir l’homme comme détenteur du pouvoir suprême et comme objet principal de toutes les attentions. Partant de là, on replace les institutions de gouvernance dans le champ des moyens toujours perfectibles.
16
La survie, le bien-être et la dignité de l’individu sont donc l’ultime objectif. Les constructions telles que l’État, la démocratie et le marché occupent dès lors une place secondaire en tant qu’outils.
17
Les menaces visant les États, les marchés et la démocratie sont autant de vulnérabilités parce qu’en fin de compte elles affectent « l’outil de production » du bien-être, des capacités, des opportunités et des libertés de l’individu.
18
Par essence, la sécurité humaine se définit comme un concept interdisciplinaire qui comporte les principales caractéristiques suivantes :
• centrée sur la personne, intégratrice et participative ;
• multisectorielle ;
• holistique ;
• spécifique au contexte ;
• orientée vers la prévention.
La sécurité humaine souligne l’interdépendance entre les différentes menaces qui se nourrissent les unes des autres et elle identifie un seuil audessous duquel la vie humaine est menacée. De fait, ses approches combinées mettent l’accent sur le besoin de réponses coopératives et multisectorielles, basées sur la mise en commun des agendas des acteurs de la sécurité, du développement et des droits de la personne.
19
Des solutions contextualisées sont donc avancées en réponse aux situations spécifiques, tout en introduisant une approche double de protection et d’autonomisation.
20
La protection implique une approche descendante – top down. Les États sont les premiers responsables de la mise en œuvre de cette structure protectrice. Alors que l’autonomisation implique une approche ascendante – down top. Elle vise à développer l’aptitude des individus et des collectivités à faire des choix éclairés et à agir en leur nom propre. Ici, protection et autonomisation se renforcent mutuellement.
21
Par ce cadre normatif, la sécurité humaine, pour laquelle les instruments de l’État devraient œuvrer efficacement et équitablement, devient tant au niveau national qu’international un bien public mondial que les États et la communauté internationale devraient se fixer comme objectif de préservation. L’efficacité d’un État ne peut être estimée que dans la mesure où il est capable d’atteindre cet objectif final.
22
À l’objectif de « croissance avec équité » du développement humain, la sécurité humaine ajoute la dimension importante de « récession avec sécurité ». En effet, la sécurité humaine reconnaît que les individus sont confrontés à des insécurités par privations soudaines suite aux récessions liées aux conflits, aux crises économiques et financières, aux maladies et catastrophes naturelles. Ces événements effacent des années de développement mais créent aussi des conditions sociales dans lesquelles les griefs peuvent donner lieu à des tensions croissantes.
23
Outre l’accent mis sur le bien-être humain, la sécurité humaine est guidée par des valeurs liées à la stabilité et la durabilité des gains de développement. Ainsi, la sécurité humaine met en évidence l’universalité et la primauté d’une série de droits et de libertés qui s’avèrent essentiels à une vie en société durable.
0/5000
مجمع مفاهيمي للتهديدات متشابكاً 9الرجل، ووضعها في قلب المشكلة، وهنا يعتبر أساسيا للأمن الدولي حيث يعتمد الأمر على في نهاية المطاف السلامة الجميع. من هذا المنظور، وضع التصاريح الفردية عن مواطن بسيط من دولة واحدة إلى أن فاعل يشارك في العلاقات الدولية. وفي الواقع، أنها تستوعب قوة النظام الدولي مما أضعف حلقاتها--مان--، وعندما هددت أمن الأفراد، الأمن الدولي أيضا.10ولذلك هو التركيز على الفرد داخل الدولة بدلاً من بنية 'الدولة' نفسها.11من النصف من القرن العشرين أن التهديدات المتعددة الوجوه وطالب بإعادة التفكير في المفاهيم التقليدية للأمن يخنقهم تاريخيا وعلى العدوان العسكري الخارجي فقط. أبعاد التهديدات إلى معدلات مرعبة لنشرها في غير ركز العابرة للحدود الوطنية التي تجعل الإطار التحليلي الذي اقترحته الأمن البشري مجموعة من الاستجابات لتعقيدها.12وهكذا، الأمن البشري مطلوب كنهج متكامل، باستخدام مجموعة واسعة من الفرص الجديدة للتصدي للتهديدات بطريقة متكاملة. وهذه تتطلب توافق جديد في آراء التي تسلم بالصلات القائمة بين التنمية ومختلف حقوق الإنسان-المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية-والأمن الوطني.13لأن التهديدات الرئيسية التي هي أساسا الداخلية وتحدث في ظروف الفشل الاقتصادي، وخرقا للحقوق الأساسية والتهميش السياسي. ولذا، الضامن للأمن الوطني ليس من القوة العسكرية ولكن مجموعة من الظروف الاجتماعية والسياسية ومواتية الاقتصادية المرتبطة بتعزيز سياسات شاملة.14يسمح نهج الأمن البشري الاعتراف على نطاق واسع مختلف التهديدات والتركيز على التجربة اليومية لانعدام الأمن الذي يشتمل عدم الوفاء بالاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة، والعمالة، والإسكان والبيئة.15قبل الذهاب إلى أبعد من ذلك، واحد يجب أن تصور الرجل كصاحب السلطة العليا ومحط اهتمام. ولذلك، نحن استبدال مؤسسات الحكم في الميدان وسائل الكمال دائماً.16بقاء ورفاه وكرامة الفرد هي الهدف النهائي. ولذلك تحتل ثوابت مثل الدولة والديمقراطية والسوق مركز ثانوي كأدوات.17الإخطار التي تهدد الدول والأسواق والديمقراطية هي العديد من نقاط الضعف لأن تؤثر في نهاية المطاف 'إنتاج أداة' الرعاية وقدرات وفرص وحريات الفرد.18في جوهرها، يتم تعريف الأمن البشري كمفهوم متعدد التخصصات التي لها السمات الرئيسية التالية:• التركيز على الشخص، شاملة وتشاركية؛• متعددة القطاعات؛• شمولية؛• سياق محدد؛• منع المنحى.الأمن البشري تؤكد على الترابط القائم بين التهديدات المختلفة التي تغذي بعضها البعض ويحدد عتبة أدناه والتي تهدد حياة الإنسان. وفي الواقع، نهجها مجتمعة تؤكد الحاجة إلى استجابات تعاونية ومتعددة القطاعات، استناداً إلى تجميع جداول أعمال الجهات الفاعلة الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.19حتى تتقدم الحلول الظرفية في الاستجابة لحالات محددة، حين الأخذ بنهج مزدوج للحماية والتمكين.20ويشمل حماية نهج من أعلى إلى أسفل-أعلى إلى أسفل. الدول المسؤولة أساسا عن تنفيذ هذا الهيكل الواقية. وفي حين يعني التمكين من أسفل--أسفل أعلى. ويهدف إلى تطوير قدرة الأفراد والمجتمعات المحلية على اتخاذ خيارات مدروسة والتصرف باسمهم. وهنا، الحماية والتمكين يعزز بعضها بعضا.21بهذا الإطار المعياري، الأمن البشري، على الصعيد الوطني والدولي على حد سواء لصكوك الدولة التي ينبغي العمل بكفاءة وإنصاف، يصبح مستوى عامة عالمية جيدة أن الدول والمجتمع الدولي ينبغي أن حددت لنفسها هدف الحفاظ على. ويمكن تقدير فعالية الدولة إلا بقدر أنه قادرة على تحقيق هذا الهدف النهائي.22الهدف من "النمو مع الإنصاف" للتنمية البشرية، أمن الإنسان يضيف بعدا هاما من "الركود مع الأمن. وفي الواقع، تسلم الأمن البشري أن الأفراد يواجهون انعدام الأمن بالتالي الحرمان المفاجئ الركود المرتبطة بالصراعات والأزمات الاقتصادية والمالية، والكوارث الطبيعية والأمراض. هذه الأحداث محو عقود تنمية، بل أيضا خلق الظروف الاجتماعية التي المظالم قد يؤدي إلى تزايد التوتر.23بالإضافة إلى التركيز على رفاهية الإنسان، والأمن البشري تسترشد بالقيم المتعلقة باستقرار واستدامة المكاسب الإنمائية. وهكذا، الأمن البشري يسلط الضوء على الطابع العالمي وسيادة مجموعة من الحقوق والحريات التي لا غنى عنها لحياة مجتمع مستدام.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


A الإطار المفاهيمي للتهديدات متشابكا معقدة
9
يعتبر الرجل في قلب المشكلة هنا ضروري لنظام الأمن الدولي الذي يعتمد في النهاية على سلامة الجميع. في هذا المنظور، تتغير حالة الفرد من أن من مواطن عادي من دولة واحدة إلى أن فاعل يشارك في العلاقات الدولية. في الواقع، واحدة يقارن قوة النظام الدولي من أضعف حلقاتها - الرجل -.، وعندما هدد أمن الفرد الأمن الدولي هو أيضا
10
وبالتالي فإن التركيز على الفرد داخل القاعدة وليس بنية "الدولة" في حد ذاته.
11
هذا هو من منتصف القرن العشرين التي طالبت التهديدات متلون لإعادة النظر في المفاهيم التقليدية للأمن ويخنقهم فقط تاريخيا على الاعتداءات العسكرية الخارجية. تهديدات لمعدلات انتشار مرعبة في أبعاد العابرة للحدود مقيدة غير أن جعل الإطار التحليلي الذي اقترحته قاعدة أمنية الإنسان جوابا على تعقيدها.
12
وهكذا، لا بد الأمن الإنساني على أكمل هذا النهج، وذلك باستخدام مجموعة واسعة إمكانيات جديدة للتصدي للتهديدات بطريقة متكاملة. يتطلب هذا الأخير إجماع جديد يعترف الروابط بين التنمية وحقوق الإنسان المختلفة - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - والأمن الوطني
13
للتهديدات الأولية تتجلى أولا في الداخلية و شروط الفشل الاقتصادي، وانتهاك حقوق الإنسان والتهميش السياسي. ولذلك، فإن الضامن للأمن الوطني ليس القوة العسكرية ولكن مجموعة من الدعم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المرتبطة تعزيز سياسات شاملة.
14
نهج الأمن البشري يسمح للاعتراف التهديدات المتنوعة على نطاق واسع والتركيز على الخبرة اليومية من انعدام الأمن الذي يشمل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة والعمل والإسكان والبيئة.
15
قبل أن يذهب أبعد من ذلك، يجب أن تكون قادرة على تصور الرجل هو صاحب السلطة العليا وبما أن الهدف الرئيسي من الاهتمام. من هناك، فإنه يضع مؤسسات الحكم في مجال وسائل دائما إلى الكمال.
16
والبقاء على قيد الحياة والرفاه والكرامة للفرد هي الهدف النهائي. المباني مثل الدولة والديمقراطية والسوق وبالتالي تحتل المرتبة الثانية كأدوات.
17
والتهديدات للدول والأسواق والديمقراطية على حد سواء الضعف لأنها تؤثر في نهاية المطاف "مرافق الإنتاج" من أجل رفاهية والقدرات والفرص والحريات للفرد
18
في جوهرها، يتم تعريف الأمن الإنساني كمفهوم متعدد التخصصات يضم الميزات الرئيسية التالية:
تركز شخص • وشمولية وتشاركية
ومتعددة القطاعات •؛
شمولي •؛
سياق محددة
• ؛. • موجهة إلى الوقاية
الأمن البشري يسلط الضوء على الترابط بين مختلف التهديدات التي تغذي بعضها البعض، ويحدد عتبة أدناه التي الحياة البشرية مهدد. في الواقع، نهجها مجتمعة تؤكد على الحاجة إلى استجابات تعاونية ومتعددة القطاعات، على أساس تقاسم أجندات الجهات الفاعلة الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
19
وتقدم الحلول سياقها . استجابة لحالات محددة، في حين أن إدخال نهج مزدوج لحماية وتمكين
20
حماية ينطوي على نهج من أعلى إلى أسفل - أعلى إلى أسفل. الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ هذا الهيكل واقية. في حين التمكين ينطوي على أسفل إلى أعلى - أعلى إلى أسفل. انها تهدف الى تطوير قدرة الأفراد والمجتمعات المحلية على اتخاذ خيارات مدروسة والعمل لحسابهم الخاص. هنا والحماية والتمكين يعززان بعضهما البعض.
21
وبهذا الإطار المعياري والأمن البشري، التي الصكوك الدولة يجب أن تعمل على نحو فعال وعادل، ويصبح على حد سواء محليا ودوليا على الصالح العام العالمي أن الدول و يجب أن المجتمع الدولي أن هدف الحفاظ عليها. فعالية للدولة ولا يمكن تقدير لأنها قادرة على تحقيق هذا الهدف النهائي.
22
في هدف "النمو مع الإنصاف" التنمية البشرية والأمن البشري يضيف بعدا هاما " الانكماش مع الأمن ". في الواقع، يعترف الأمن الإنساني التي يواجهها الأفراد مع انعدام الأمن المفاجئة بالحرمان بعد الركود المتعلقة بالنزاع، والأزمات الاقتصادية والمالية والكوارث الطبيعية والأمراض. هذه الأحداث تمحو سنوات من التنمية ولكن أيضا خلق الظروف الاجتماعية التي مظالم يمكن أن يؤدي إلى تزايد التوترات.
23
بالإضافة إلى التركيز على رفاهية الإنسان، ويسترشد الأمن الإنساني القيم المتعلقة بالاستقرار واستدامة المكاسب الإنمائية. وهكذا، والأمن البشري يؤكد على عالمية وأولوية سلسلة من الحقوق والحريات التي هي ضرورية لحياة في مجتمع مستدام.
9
يعتبر الرجل في قلب المشكلة هنا ضروري لنظام الأمن الدولي الذي يعتمد في النهاية على سلامة الجميع. في هذا المنظور، تتغير حالة الفرد من أن من مواطن عادي من دولة واحدة إلى أن فاعل يشارك في العلاقات الدولية. في الواقع، واحدة يقارن قوة النظام الدولي من أضعف حلقاتها - الرجل -.، وعندما هدد أمن الفرد الأمن الدولي هو أيضا
10
وبالتالي فإن التركيز على الفرد داخل القاعدة وليس بنية "الدولة" في حد ذاته.
11
هذا هو من منتصف القرن العشرين التي طالبت التهديدات متلون لإعادة النظر في المفاهيم التقليدية للأمن ويخنقهم فقط تاريخيا على الاعتداءات العسكرية الخارجية. تهديدات لمعدلات انتشار مرعبة في أبعاد العابرة للحدود مقيدة غير أن جعل الإطار التحليلي الذي اقترحته قاعدة أمنية الإنسان جوابا على تعقيدها.
12
وهكذا، لا بد الأمن الإنساني على أكمل هذا النهج، وذلك باستخدام مجموعة واسعة إمكانيات جديدة للتصدي للتهديدات بطريقة متكاملة. يتطلب هذا الأخير إجماع جديد يعترف الروابط بين التنمية وحقوق الإنسان المختلفة - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - والأمن الوطني
13
للتهديدات الأولية تتجلى أولا في الداخلية و شروط الفشل الاقتصادي، وانتهاك حقوق الإنسان والتهميش السياسي. ولذلك، فإن الضامن للأمن الوطني ليس القوة العسكرية ولكن مجموعة من الدعم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المرتبطة تعزيز سياسات شاملة.
14
نهج الأمن البشري يسمح للاعتراف التهديدات المتنوعة على نطاق واسع والتركيز على الخبرة اليومية من انعدام الأمن الذي يشمل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة والعمل والإسكان والبيئة.
15
قبل أن يذهب أبعد من ذلك، يجب أن تكون قادرة على تصور الرجل هو صاحب السلطة العليا وبما أن الهدف الرئيسي من الاهتمام. من هناك، فإنه يضع مؤسسات الحكم في مجال وسائل دائما إلى الكمال.
16
والبقاء على قيد الحياة والرفاه والكرامة للفرد هي الهدف النهائي. المباني مثل الدولة والديمقراطية والسوق وبالتالي تحتل المرتبة الثانية كأدوات.
17
والتهديدات للدول والأسواق والديمقراطية على حد سواء الضعف لأنها تؤثر في نهاية المطاف "مرافق الإنتاج" من أجل رفاهية والقدرات والفرص والحريات للفرد
18
في جوهرها، يتم تعريف الأمن الإنساني كمفهوم متعدد التخصصات يضم الميزات الرئيسية التالية:
تركز شخص • وشمولية وتشاركية
ومتعددة القطاعات •؛
شمولي •؛
سياق محددة
• ؛. • موجهة إلى الوقاية
الأمن البشري يسلط الضوء على الترابط بين مختلف التهديدات التي تغذي بعضها البعض، ويحدد عتبة أدناه التي الحياة البشرية مهدد. في الواقع، نهجها مجتمعة تؤكد على الحاجة إلى استجابات تعاونية ومتعددة القطاعات، على أساس تقاسم أجندات الجهات الفاعلة الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
19
وتقدم الحلول سياقها . استجابة لحالات محددة، في حين أن إدخال نهج مزدوج لحماية وتمكين
20
حماية ينطوي على نهج من أعلى إلى أسفل - أعلى إلى أسفل. الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ هذا الهيكل واقية. في حين التمكين ينطوي على أسفل إلى أعلى - أعلى إلى أسفل. انها تهدف الى تطوير قدرة الأفراد والمجتمعات المحلية على اتخاذ خيارات مدروسة والعمل لحسابهم الخاص. هنا والحماية والتمكين يعززان بعضهما البعض.
21
وبهذا الإطار المعياري والأمن البشري، التي الصكوك الدولة يجب أن تعمل على نحو فعال وعادل، ويصبح على حد سواء محليا ودوليا على الصالح العام العالمي أن الدول و يجب أن المجتمع الدولي أن هدف الحفاظ عليها. فعالية للدولة ولا يمكن تقدير لأنها قادرة على تحقيق هذا الهدف النهائي.
22
في هدف "النمو مع الإنصاف" التنمية البشرية والأمن البشري يضيف بعدا هاما " الانكماش مع الأمن ". في الواقع، يعترف الأمن الإنساني التي يواجهها الأفراد مع انعدام الأمن المفاجئة بالحرمان بعد الركود المتعلقة بالنزاع، والأزمات الاقتصادية والمالية والكوارث الطبيعية والأمراض. هذه الأحداث تمحو سنوات من التنمية ولكن أيضا خلق الظروف الاجتماعية التي مظالم يمكن أن يؤدي إلى تزايد التوترات.
23
بالإضافة إلى التركيز على رفاهية الإنسان، ويسترشد الأمن الإنساني القيم المتعلقة بالاستقرار واستدامة المكاسب الإنمائية. وهكذا، والأمن البشري يؤكد على عالمية وأولوية سلسلة من الحقوق والحريات التي هي ضرورية لحياة في مجتمع مستدام.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


إطار مفاهيمي تشابك معقد
التهديد 9 أشخاص، على مشاكل في القلب، هو أن النظام الأمني الدولي، يعتمد في نهاية المطاف على سلامة الجميع.في هذه الحالة، موقف الفرد من المواطنين العاديين من خلال المشاركة الوطنية فاعل في العلاقات الدولية.في الواقع،لدينا قوة النظام الدولي هو الأضعف - الإنسان - الفرد للخطر، والأمن الدولي....... 10
هي التي تركز على فرادى البلدان، وليس على هيكل "الوطنية" في حد ذاته 11.......
هذا هو النصف الأول من القرن العشرين، تحتاج إلى إعادة التفكير في تغير التهديدات الأمنية التقليدية مفهوم التاريخ قبل العدوان العسكري الخارجي فقط.سرعة انتشار رهيبة تهدد حجم غير محدود عبر تحليل الإطار المقترح قاعدة الأمن البشري الجواب
12 التعقيد. ولذلك، متطلبات الأمن البشري بوصفه طريقة التكامل، واستخدام مجموعة واسعة من إمكانيات جديدة، بطريقة متكاملة لمعالجة التهديدات.هذه الشروط توافق جديد في اﻵراء بأن تطوير العلاقات بين مختلف الأفراد في الحقوق - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن الوطني 13.......
لأن التهديد الرئيسي هو أولا في الظروف الاقتصادية الداخلية و الفشل، انتهاكا للحقوق الأساسية في سياسة التهميش.لذلك، لضمان أمن الدولة القوة العسكرية، وليس مجموعة من الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسياسات التفضيلية مع تعزيز الشمول 14.......
طريقة التعرف التي تهدد الأمن البشري من خلال تنوع اهتمام واسع الخبرة اليومية وانعدام الأمن، بما في ذلك عدم تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء، والصحة، والعمالة، والإسكان والبيئة.......
قبل 15 تذهب أبعد من ذلك.يجب أن تكون قادرة على تصميم رجل السلطة العليا، وهذا هو الهدف الرئيسي من جميع الاحتياطات.ولذلك، فإننا سوف مؤسسات الحكم في هذا المجال طريقة دائما مثالية.......
بقاء 16 و رفاهية و كرامة الفرد هو الهدف النهائي.المباني، مثل الدولالديمقراطية و حصة السوق موقف الثانوية، ولذلك كأداة تهديد الدول 17.......
، السوق والديمقراطية هي الضعف، لأنه يؤثر في نهاية المطاف على أنها "أداة الإنتاج" الرعاية والقدرة والفرص والحريات الشخصية
18 جوهر.تعريف الأمن البشري هو مفهوم متعدد التخصصات مع الميزات الرئيسية التالية:
• الفرد مركز، شاملة وتشاركية،
• القطاعات ككل؛
• •؛ خاصة في السياق؛
• الوقاية الموجهة.الترابط بين الأمن البشري على التهديدات المختلفة إلى بعضها البعض، وهو تحديد عتبة، في حياة الناس للخطر....... في الواقع، انها طريقة الجمع على ضرورة الإجابة على أساس التعاون المتعدد القطاعات، وتحقيق الأمن المشترك يوميات الفاعل،التنمية و حقوق الإنسان.......
الحل هو طرح 19 حالة استجابة محددة، عرض مزدوج طريقة الحماية والتمكين.......
حماية 20 بما في ذلك نهج من أعلى إلى أسفل – أعلى.الولايات المتحدة هي أول مسؤولة عن تنفيذ هذه الحماية.و إذن يعني النهج التصاعدي – تانغ.والهدف من ذلك هو تطوير قدرات الأفراد والمجتمعات من اتخاذ قرارات مستنيرة و العمل باسمه.هنا، وحماية السلطة هو الآخر.......
21 الإطار المعياري، الأمن البشريالدولة يجب أن تكون عادلة أداة فعالة، على الصعيدين الوطني والدولي إحدى المنافع العالمية العامة، جميع الدول والمجتمع الدولي أن الحفاظ على الأهداف التي حددتها لنفسها.بلد لا يمكن تقدير مدى كفاءة، فإنه يمكن تحقيق هذا الهدف في نهاية المطاف 22
.في "الإنصاف" أهداف النمو والتنمية البشرية والأمن البشري، أهم أبعاد الأمن إضافة "الركود".في الواقع، الأمن البشري يعترف الشخص تواجه انعدام الأمن ونقص الصراع فجأة الركود و الأزمة المالية، الأمراض و الكوارث الطبيعية.هذه الأحداث سوف سنوات من التنمية، ولكن أيضا خلق الظروف الاجتماعية التي قد تنتج عن ضغوط متزايدة.......
23 زيادة التشديد على رفاه البشر، هي القيم الإنسانية بتوجيه من الأمن و الاستقرار والمتانة.ولذلك،الأمن البشري بارزة عالمية أولى سلسلة من الحقوق والحريات، وهذا أمر حاسم في التنمية المستدامة في المجتمع.......
التهديد 9 أشخاص، على مشاكل في القلب، هو أن النظام الأمني الدولي، يعتمد في نهاية المطاف على سلامة الجميع.في هذه الحالة، موقف الفرد من المواطنين العاديين من خلال المشاركة الوطنية فاعل في العلاقات الدولية.في الواقع،لدينا قوة النظام الدولي هو الأضعف - الإنسان - الفرد للخطر، والأمن الدولي....... 10
هي التي تركز على فرادى البلدان، وليس على هيكل "الوطنية" في حد ذاته 11.......
هذا هو النصف الأول من القرن العشرين، تحتاج إلى إعادة التفكير في تغير التهديدات الأمنية التقليدية مفهوم التاريخ قبل العدوان العسكري الخارجي فقط.سرعة انتشار رهيبة تهدد حجم غير محدود عبر تحليل الإطار المقترح قاعدة الأمن البشري الجواب
12 التعقيد. ولذلك، متطلبات الأمن البشري بوصفه طريقة التكامل، واستخدام مجموعة واسعة من إمكانيات جديدة، بطريقة متكاملة لمعالجة التهديدات.هذه الشروط توافق جديد في اﻵراء بأن تطوير العلاقات بين مختلف الأفراد في الحقوق - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن الوطني 13.......
لأن التهديد الرئيسي هو أولا في الظروف الاقتصادية الداخلية و الفشل، انتهاكا للحقوق الأساسية في سياسة التهميش.لذلك، لضمان أمن الدولة القوة العسكرية، وليس مجموعة من الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسياسات التفضيلية مع تعزيز الشمول 14.......
طريقة التعرف التي تهدد الأمن البشري من خلال تنوع اهتمام واسع الخبرة اليومية وانعدام الأمن، بما في ذلك عدم تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء، والصحة، والعمالة، والإسكان والبيئة.......
قبل 15 تذهب أبعد من ذلك.يجب أن تكون قادرة على تصميم رجل السلطة العليا، وهذا هو الهدف الرئيسي من جميع الاحتياطات.ولذلك، فإننا سوف مؤسسات الحكم في هذا المجال طريقة دائما مثالية.......
بقاء 16 و رفاهية و كرامة الفرد هو الهدف النهائي.المباني، مثل الدولالديمقراطية و حصة السوق موقف الثانوية، ولذلك كأداة تهديد الدول 17.......
، السوق والديمقراطية هي الضعف، لأنه يؤثر في نهاية المطاف على أنها "أداة الإنتاج" الرعاية والقدرة والفرص والحريات الشخصية
18 جوهر.تعريف الأمن البشري هو مفهوم متعدد التخصصات مع الميزات الرئيسية التالية:
• الفرد مركز، شاملة وتشاركية،
• القطاعات ككل؛
• •؛ خاصة في السياق؛
• الوقاية الموجهة.الترابط بين الأمن البشري على التهديدات المختلفة إلى بعضها البعض، وهو تحديد عتبة، في حياة الناس للخطر....... في الواقع، انها طريقة الجمع على ضرورة الإجابة على أساس التعاون المتعدد القطاعات، وتحقيق الأمن المشترك يوميات الفاعل،التنمية و حقوق الإنسان.......
الحل هو طرح 19 حالة استجابة محددة، عرض مزدوج طريقة الحماية والتمكين.......
حماية 20 بما في ذلك نهج من أعلى إلى أسفل – أعلى.الولايات المتحدة هي أول مسؤولة عن تنفيذ هذه الحماية.و إذن يعني النهج التصاعدي – تانغ.والهدف من ذلك هو تطوير قدرات الأفراد والمجتمعات من اتخاذ قرارات مستنيرة و العمل باسمه.هنا، وحماية السلطة هو الآخر.......
21 الإطار المعياري، الأمن البشريالدولة يجب أن تكون عادلة أداة فعالة، على الصعيدين الوطني والدولي إحدى المنافع العالمية العامة، جميع الدول والمجتمع الدولي أن الحفاظ على الأهداف التي حددتها لنفسها.بلد لا يمكن تقدير مدى كفاءة، فإنه يمكن تحقيق هذا الهدف في نهاية المطاف 22
.في "الإنصاف" أهداف النمو والتنمية البشرية والأمن البشري، أهم أبعاد الأمن إضافة "الركود".في الواقع، الأمن البشري يعترف الشخص تواجه انعدام الأمن ونقص الصراع فجأة الركود و الأزمة المالية، الأمراض و الكوارث الطبيعية.هذه الأحداث سوف سنوات من التنمية، ولكن أيضا خلق الظروف الاجتماعية التي قد تنتج عن ضغوط متزايدة.......
23 زيادة التشديد على رفاه البشر، هي القيم الإنسانية بتوجيه من الأمن و الاستقرار والمتانة.ولذلك،الأمن البشري بارزة عالمية أولى سلسلة من الحقوق والحريات، وهذا أمر حاسم في التنمية المستدامة في المجتمع.......
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.
- حبيت ناديك بأسمك لشوف كيف بترد، ، هاي لع
- وليه روحت تجارة
- في سنة كام
- زوجي رجع للبيت
- في سنة كام
- هل تتكلمين العربية
- نلاحظ تزايد في معدل السكان
- هل تتكلمين العربية
- There is no competitor for Engin
- زوجي عاد إلى المنزل
- انت في سنة كام
- وعدتني ان لا تتركنيوبعد ذلك غادرت
- انا سعيد بردك
- انت في سنة كام
- بله هرجورکوچیک
- وتركتني
- وانا اريدك معي في كل وقت
- شكرا على حسن تفهمك
- 4/Diplomatie économique et sécurité huma
- وتركتني
- نعم انا ليه حبيب وبحبه
- This post is meant to describe the graph
- بله هرجورکوچیک بوزورک میانه مخاهم بوبینم
- لا استطيع ان اعيش من دونك