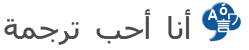- النص
- تاريخ
Contenir la révolte du G173 19Les c
Contenir la révolte du G173
19
Les caractéristiques propres aux rassemblements ad hoc (ex. pas d’élection des membres, pas de représentativité autre que celle de la puissance économique, pas de vocation universelle) expliquent les réserves d’un grand nombre des nations devant, notamment, l’émergence des BRIC, de l’IBSA ou encore du G20. Une « révolte » des 173 États des Nations unies qui n’appartiennent pas ou pas encore à un G20 « + » se fait jour. Elle impose de renforcer à la fois la légitimité des rassemblements ad hoc et une meilleure association des Nations unies aux travaux des enceintes récemment créées. C’est ce à quoi s’efforce le G20, plus que tout autre, même si cette instance a pris son envol dans l’urgence. La succession des sommets, deux par an, n’a pas permis de mettre en place une concertation structurée avec les autres membres des Nations unies, voire l’ONU elle-même alors qu’elle demeure l’organe de légitimité essentiel du système multilatéral.
20
Structurer les dialogues avec les Nations unies, c’est affirmer sa puissance normative, asseoir la légitimité de l’institution et inscrire son action dans la durée. Cet effort est aussi la traduction d’un apprentissage diplomatique. La leçon de l’échec des négociations sur le climat à Copenhague a convaincu bien des diplomaties que seule l’approche la plus inclusive possible est susceptible d’éviter la division de la communauté internationale. Toutefois, à l’image du G20, les institutions transnationales naissantes hésitent à affirmer que l’une de leur première priorité est la réforme de la gouvernance mondiale dans son ensemble. Si certains États ne sont pas opposés à l’inscription du thème à leur agenda institutionnel, compte tenu de l’importance du sujet, ils ne s’en interrogent pas moins sur les avancées qui peuvent être espérées. Pour beaucoup, les deux grands thèmes promus par la présidence française du G20 (réforme du système monétaire international et régulation des prix des matières premières) suffisent à constituer un programme ambitieux, étant entendu que la mise en œuvre des mesures déjà agréées dans le domaine de la régulation financière demeure encore une obligation urgente. Cependant, la réforme des Nations unies devient d’autant plus indispensable que les institutions financières internationales sont en pleine évolution. À cet égard, la réforme du Conseil de sécurité constitue une priorité, même s’il ne s’agit pas de se montrer prescriptif sur un sujet qui relève de la compétence de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU). De ce point de vue, l’année 2011 est une opportunité à saisir compte tenu de la composition du Conseil de sécurité à venir (l’Allemagne, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud figureront parmi les non permanents).
21
Le rôle original du G20 vis-à-vis de tout autre rassemblement interétatique ad hoc serait donc d’apporter une impulsion politique pour permettre à l’AGNU de dépasser ses blocages internes. Autrement dit, comme d’autres instances, la légitimité du G20 pourrait bien se bâtir non pas tant sur sa représentativité du monde que sur son efficacité économique et diplomatique. Cependant, cette efficience possible ne saurait occulter les débats qui ne manqueront pas de s’intensifier sur l’élargissement à des nouveaux États membres (ex. Algérie, Égypte, etc.) ou à l’association systématique d’organisations régionales pour être plus représentatif. Il ne faut pas s’en inquiéter car il n’existe pas aujourd’hui une seule institution internationale, récente ou ancienne, qui ne soit pas traversée par des débats sur ses contours géographiques, fonctionnels et le nombre de ses États membres. Ce débat n’est pas sans importance n’ont seulement pour le G173 mais il l’est plus encore pour les Européens qu’ils soient fédéralistes ou souverainistes.
22
Certains experts, notamment aux États-Unis et en Asie orientale, ne cachent pas que la façon la plus simple d’élargir les institutions internationales et en premier lieu le G20, sans étendre à l’infini le nombre des États membres, c’est d’abord de réduire le nombre des Européens en créant pour eux tous « un » siège dévolu à l’Union. Un consensus hors d’Europe s’esquisse pour affirmer que les pays européens sont surreprésentés (double représentation de certains États membres au travers des institutions européennes ; existence d’un groupe régional de facto). Avant de s’inquiéter des conséquences algébriques de ce constat, il faut y voir un formidable hommage à la crédibilité de la construction de l’Union et pourquoi pas une opportunité pour un renforcement de la dynamique d’intégration. Avant de subir par la pression conjuguée des États-Unis, de la Russie et des puissances émergentes ce ré-ordonnancement des institutions internationales anciennes ou plus récentes, faisons au moins mine de faire de cette perspective un objectif politique affiché. Cette « bonne volonté » permettra, peut-être, aux États européens de bâtir entre eux de nouveaux mécanismes de convergence et de solidarité mais aussi de choisir leurs « successeurs » dans les enceintes internationales. Au G20, l’instauration d’un siège européen unique en libérera pas moins de quatre, permettant ainsi l’élargissement à de nouveaux émergents et de répondre au besoin d’inclusivité plus forte du groupe. Ceteris paribus, il serait erroné de croire que l’élargissement, facilité par la mise en place d’un siège européen, règlera la question de la légitimité du G20 ou de toute autre organisation. N’oublions pas que le G20 et le foisonnement récent des organisations transnationales est aussi le résultat de l’inefficacité des Nations unies. Le G173 devait donc prendre la création de ces clubs comme une alerte « salutaire » sur leur progressive marginalisation dans la gouvernance mondiale. Néanmoins, si des contributions de qualité sont apportées par l’ONU sur le fond des débats des institutions naissantes qui veulent aider à la réforme de la gouvernance mondiale, les politiques de développement, l’aide aux pays les plus vulnérables… alors le risque de voir l’agenda du G20 ne cesser à l’avenir de s’étendre, diminuera d’autant.
23
Le G20, comme tous les autres clubs, est un espace politique informel dont les engagements n’ont pas de valeur juridique et ne s’imposent donc pas, ipso facto, aux États non-membres. Il ne représente, ni ne prétend représenter les autres États. En revanche, son poids démographique (deux tiers de la population mondiale), économique (85 % du PIB) et politique en fait un élément original et incontournable de la nouvelle scène internationale. Cela suffit en soi à lui conférer une certaine légitimité et si l’idée de renforcer cette dernière s’impose va dans le bon sens, il conviendra que cela ne se fit pas au détriment de son efficacité. Si certains pays comme le groupe de l’ALBA choisissent de s’opposer à ses décisions ou recommandations, c’est leur affaire mais ils s’isoleront d’eux-mêmes se faisant du reste du monde.
24
Le processus de consultation du G20 et des Nations unies, récemment imaginé, ôte aux contestataires un argument utile pour rallier des soutiens auprès d’États relativement neutres jusqu’à présent, les isolant à défaut de pouvoir les convaincre. Dans le même temps, l’attitude coopérative des puissances « émergentes » au sein du G20 doit être renforcée car elle limitera le risque que leur solidarité traditionnelle avec le G77 ne les mette en porteà-faux. Il est crucial de faire émerger chez ces nouveaux partenaires un sens plus aigu des responsabilités et des devoirs qui devraient accompagner leur accession à un statut « nouveau » au sein des grandes enceintes internationales de concertation. Toutefois, le maintien des ministres de l’Économie plutôt que des ministres des Affaires étrangères comme chefs de file sur le G20 complique la prise en charge de questions relatives à la gouvernance globale et la coordination avec les Nations unies. C’est d’autant plus dommageable que l’intégration inconditionnelle des émergents a privé les puissances établies du quid pro quo qui était au cœur du processus d’Heiligendamm, lancé en juin 2007 par le G8 sous présidence allemande (cf. participation probatoire à des ateliers où seraient testées la volonté politique et les capacités technico-juridico-administratives des accédants à s’engager sur des agendas collectifs comme condition préalable à une intégration future mais prochaine).
25
Aujourd’hui, on est dans une situation où les puissances émergentes sont les bénéficiaires d’une « divine surprise ». Sollicitées pour adhérer au club des puissances globales et seules à même de capter l’énergie de l’ensemble des discours critiques de l’ordre mondial, elles sont les « hôtes muets » de la réforme de la gouvernance. Elles se trouvent intégrées au cercle des principales puissances sans avoir eu à exposer leur conception des relations internationales au-delà du rappel de leur attachement à leur souveraineté, ni à se compromettre sur la définition et la promotion de leurs intérêts nationaux. Cet état de fait ne pourra perdurer sans risquer de miner l’objectif d’une refonte de la gouvernance mondiale car il laisserait apparaître le G20 comme l’instrument de manipulation des puissances émergentes par celles qui sont installées depuis longtemps. Dans ce contexte, les États « exclus » ne s’en montreront pas moins attentifs à ce que les compétences des institutions des Nations unies soient préservées, en particulier celles de l’Assemblée générale en matière de réforme du Conseil de sécurité.
26
Il est donc utile que les Nations unies soient systématiquement associées aux discussions et aux travaux en amont, ce qui ne veut pas dire pour autant que le G20 soit subordonné à l’ONU et à ses agences. Ce mécanisme passera par une formalisation de l’invitation du secrétaire général (SGNU) aux sommets, une association étroite du sherpa du SGNU (Kwame Sundaram Jomo) et son
19
Les caractéristiques propres aux rassemblements ad hoc (ex. pas d’élection des membres, pas de représentativité autre que celle de la puissance économique, pas de vocation universelle) expliquent les réserves d’un grand nombre des nations devant, notamment, l’émergence des BRIC, de l’IBSA ou encore du G20. Une « révolte » des 173 États des Nations unies qui n’appartiennent pas ou pas encore à un G20 « + » se fait jour. Elle impose de renforcer à la fois la légitimité des rassemblements ad hoc et une meilleure association des Nations unies aux travaux des enceintes récemment créées. C’est ce à quoi s’efforce le G20, plus que tout autre, même si cette instance a pris son envol dans l’urgence. La succession des sommets, deux par an, n’a pas permis de mettre en place une concertation structurée avec les autres membres des Nations unies, voire l’ONU elle-même alors qu’elle demeure l’organe de légitimité essentiel du système multilatéral.
20
Structurer les dialogues avec les Nations unies, c’est affirmer sa puissance normative, asseoir la légitimité de l’institution et inscrire son action dans la durée. Cet effort est aussi la traduction d’un apprentissage diplomatique. La leçon de l’échec des négociations sur le climat à Copenhague a convaincu bien des diplomaties que seule l’approche la plus inclusive possible est susceptible d’éviter la division de la communauté internationale. Toutefois, à l’image du G20, les institutions transnationales naissantes hésitent à affirmer que l’une de leur première priorité est la réforme de la gouvernance mondiale dans son ensemble. Si certains États ne sont pas opposés à l’inscription du thème à leur agenda institutionnel, compte tenu de l’importance du sujet, ils ne s’en interrogent pas moins sur les avancées qui peuvent être espérées. Pour beaucoup, les deux grands thèmes promus par la présidence française du G20 (réforme du système monétaire international et régulation des prix des matières premières) suffisent à constituer un programme ambitieux, étant entendu que la mise en œuvre des mesures déjà agréées dans le domaine de la régulation financière demeure encore une obligation urgente. Cependant, la réforme des Nations unies devient d’autant plus indispensable que les institutions financières internationales sont en pleine évolution. À cet égard, la réforme du Conseil de sécurité constitue une priorité, même s’il ne s’agit pas de se montrer prescriptif sur un sujet qui relève de la compétence de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU). De ce point de vue, l’année 2011 est une opportunité à saisir compte tenu de la composition du Conseil de sécurité à venir (l’Allemagne, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud figureront parmi les non permanents).
21
Le rôle original du G20 vis-à-vis de tout autre rassemblement interétatique ad hoc serait donc d’apporter une impulsion politique pour permettre à l’AGNU de dépasser ses blocages internes. Autrement dit, comme d’autres instances, la légitimité du G20 pourrait bien se bâtir non pas tant sur sa représentativité du monde que sur son efficacité économique et diplomatique. Cependant, cette efficience possible ne saurait occulter les débats qui ne manqueront pas de s’intensifier sur l’élargissement à des nouveaux États membres (ex. Algérie, Égypte, etc.) ou à l’association systématique d’organisations régionales pour être plus représentatif. Il ne faut pas s’en inquiéter car il n’existe pas aujourd’hui une seule institution internationale, récente ou ancienne, qui ne soit pas traversée par des débats sur ses contours géographiques, fonctionnels et le nombre de ses États membres. Ce débat n’est pas sans importance n’ont seulement pour le G173 mais il l’est plus encore pour les Européens qu’ils soient fédéralistes ou souverainistes.
22
Certains experts, notamment aux États-Unis et en Asie orientale, ne cachent pas que la façon la plus simple d’élargir les institutions internationales et en premier lieu le G20, sans étendre à l’infini le nombre des États membres, c’est d’abord de réduire le nombre des Européens en créant pour eux tous « un » siège dévolu à l’Union. Un consensus hors d’Europe s’esquisse pour affirmer que les pays européens sont surreprésentés (double représentation de certains États membres au travers des institutions européennes ; existence d’un groupe régional de facto). Avant de s’inquiéter des conséquences algébriques de ce constat, il faut y voir un formidable hommage à la crédibilité de la construction de l’Union et pourquoi pas une opportunité pour un renforcement de la dynamique d’intégration. Avant de subir par la pression conjuguée des États-Unis, de la Russie et des puissances émergentes ce ré-ordonnancement des institutions internationales anciennes ou plus récentes, faisons au moins mine de faire de cette perspective un objectif politique affiché. Cette « bonne volonté » permettra, peut-être, aux États européens de bâtir entre eux de nouveaux mécanismes de convergence et de solidarité mais aussi de choisir leurs « successeurs » dans les enceintes internationales. Au G20, l’instauration d’un siège européen unique en libérera pas moins de quatre, permettant ainsi l’élargissement à de nouveaux émergents et de répondre au besoin d’inclusivité plus forte du groupe. Ceteris paribus, il serait erroné de croire que l’élargissement, facilité par la mise en place d’un siège européen, règlera la question de la légitimité du G20 ou de toute autre organisation. N’oublions pas que le G20 et le foisonnement récent des organisations transnationales est aussi le résultat de l’inefficacité des Nations unies. Le G173 devait donc prendre la création de ces clubs comme une alerte « salutaire » sur leur progressive marginalisation dans la gouvernance mondiale. Néanmoins, si des contributions de qualité sont apportées par l’ONU sur le fond des débats des institutions naissantes qui veulent aider à la réforme de la gouvernance mondiale, les politiques de développement, l’aide aux pays les plus vulnérables… alors le risque de voir l’agenda du G20 ne cesser à l’avenir de s’étendre, diminuera d’autant.
23
Le G20, comme tous les autres clubs, est un espace politique informel dont les engagements n’ont pas de valeur juridique et ne s’imposent donc pas, ipso facto, aux États non-membres. Il ne représente, ni ne prétend représenter les autres États. En revanche, son poids démographique (deux tiers de la population mondiale), économique (85 % du PIB) et politique en fait un élément original et incontournable de la nouvelle scène internationale. Cela suffit en soi à lui conférer une certaine légitimité et si l’idée de renforcer cette dernière s’impose va dans le bon sens, il conviendra que cela ne se fit pas au détriment de son efficacité. Si certains pays comme le groupe de l’ALBA choisissent de s’opposer à ses décisions ou recommandations, c’est leur affaire mais ils s’isoleront d’eux-mêmes se faisant du reste du monde.
24
Le processus de consultation du G20 et des Nations unies, récemment imaginé, ôte aux contestataires un argument utile pour rallier des soutiens auprès d’États relativement neutres jusqu’à présent, les isolant à défaut de pouvoir les convaincre. Dans le même temps, l’attitude coopérative des puissances « émergentes » au sein du G20 doit être renforcée car elle limitera le risque que leur solidarité traditionnelle avec le G77 ne les mette en porteà-faux. Il est crucial de faire émerger chez ces nouveaux partenaires un sens plus aigu des responsabilités et des devoirs qui devraient accompagner leur accession à un statut « nouveau » au sein des grandes enceintes internationales de concertation. Toutefois, le maintien des ministres de l’Économie plutôt que des ministres des Affaires étrangères comme chefs de file sur le G20 complique la prise en charge de questions relatives à la gouvernance globale et la coordination avec les Nations unies. C’est d’autant plus dommageable que l’intégration inconditionnelle des émergents a privé les puissances établies du quid pro quo qui était au cœur du processus d’Heiligendamm, lancé en juin 2007 par le G8 sous présidence allemande (cf. participation probatoire à des ateliers où seraient testées la volonté politique et les capacités technico-juridico-administratives des accédants à s’engager sur des agendas collectifs comme condition préalable à une intégration future mais prochaine).
25
Aujourd’hui, on est dans une situation où les puissances émergentes sont les bénéficiaires d’une « divine surprise ». Sollicitées pour adhérer au club des puissances globales et seules à même de capter l’énergie de l’ensemble des discours critiques de l’ordre mondial, elles sont les « hôtes muets » de la réforme de la gouvernance. Elles se trouvent intégrées au cercle des principales puissances sans avoir eu à exposer leur conception des relations internationales au-delà du rappel de leur attachement à leur souveraineté, ni à se compromettre sur la définition et la promotion de leurs intérêts nationaux. Cet état de fait ne pourra perdurer sans risquer de miner l’objectif d’une refonte de la gouvernance mondiale car il laisserait apparaître le G20 comme l’instrument de manipulation des puissances émergentes par celles qui sont installées depuis longtemps. Dans ce contexte, les États « exclus » ne s’en montreront pas moins attentifs à ce que les compétences des institutions des Nations unies soient préservées, en particulier celles de l’Assemblée générale en matière de réforme du Conseil de sécurité.
26
Il est donc utile que les Nations unies soient systématiquement associées aux discussions et aux travaux en amont, ce qui ne veut pas dire pour autant que le G20 soit subordonné à l’ONU et à ses agences. Ce mécanisme passera par une formalisation de l’invitation du secrétaire général (SGNU) aux sommets, une association étroite du sherpa du SGNU (Kwame Sundaram Jomo) et son
0/5000
احتواء ثورة G173 19خصائص التجمعات المخصصة (مثلاً لا لانتخاب الأعضاء، أي تمثيل بخلاف ذلك من قوة اقتصادية عالمية لا) شرح التحفظات التي أبداها عدد كبير من الأمم، في جملة أمور، ظهور البرازيل، المجموعة ومجموعة ال 20. A 'الثورة' من 173 دولة من الأمم المتحدة والتي ليست أم لا بعد مجموعة ال 20 '+' تبرز. أنه يتطلب تعزيز شرعية التجمعات المخصصة وارتباط أفضل من الأمم المتحدة في أعمال مكبرات الصوت الذي تم إنشاؤه مؤخرا. ما يحاول G20، أكثر من أي دولة أخرى، حتى إذا كانت هذه الحالة قد أقلعت في عجلة من أمرنا. الخلافة مؤتمرات، اثنين في السنة، وقد أخفقت في إقامة حوار منظم مع سائر أعضاء الأمم المتحدة، أو حتى الأمم المتحدة نفسها حتى يظل الجسم الأساسي لشرعية النظام المتعدد الأطراف.20Structurer les dialogues avec les Nations unies, c’est affirmer sa puissance normative, asseoir la légitimité de l’institution et inscrire son action dans la durée. Cet effort est aussi la traduction d’un apprentissage diplomatique. La leçon de l’échec des négociations sur le climat à Copenhague a convaincu bien des diplomaties que seule l’approche la plus inclusive possible est susceptible d’éviter la division de la communauté internationale. Toutefois, à l’image du G20, les institutions transnationales naissantes hésitent à affirmer que l’une de leur première priorité est la réforme de la gouvernance mondiale dans son ensemble. Si certains États ne sont pas opposés à l’inscription du thème à leur agenda institutionnel, compte tenu de l’importance du sujet, ils ne s’en interrogent pas moins sur les avancées qui peuvent être espérées. Pour beaucoup, les deux grands thèmes promus par la présidence française du G20 (réforme du système monétaire international et régulation des prix des matières premières) suffisent à constituer un programme ambitieux, étant entendu que la mise en œuvre des mesures déjà agréées dans le domaine de la régulation financière demeure encore une obligation urgente. Cependant, la réforme des Nations unies devient d’autant plus indispensable que les institutions financières internationales sont en pleine évolution. À cet égard, la réforme du Conseil de sécurité constitue une priorité, même s’il ne s’agit pas de se montrer prescriptif sur un sujet qui relève de la compétence de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU). De ce point de vue, l’année 2011 est une opportunité à saisir compte tenu de la composition du Conseil de sécurité à venir (l’Allemagne, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud figureront parmi les non permanents).21Le rôle original du G20 vis-à-vis de tout autre rassemblement interétatique ad hoc serait donc d’apporter une impulsion politique pour permettre à l’AGNU de dépasser ses blocages internes. Autrement dit, comme d’autres instances, la légitimité du G20 pourrait bien se bâtir non pas tant sur sa représentativité du monde que sur son efficacité économique et diplomatique. Cependant, cette efficience possible ne saurait occulter les débats qui ne manqueront pas de s’intensifier sur l’élargissement à des nouveaux États membres (ex. Algérie, Égypte, etc.) ou à l’association systématique d’organisations régionales pour être plus représentatif. Il ne faut pas s’en inquiéter car il n’existe pas aujourd’hui une seule institution internationale, récente ou ancienne, qui ne soit pas traversée par des débats sur ses contours géographiques, fonctionnels et le nombre de ses États membres. Ce débat n’est pas sans importance n’ont seulement pour le G173 mais il l’est plus encore pour les Européens qu’ils soient fédéralistes ou souverainistes.22Certains experts, notamment aux États-Unis et en Asie orientale, ne cachent pas que la façon la plus simple d’élargir les institutions internationales et en premier lieu le G20, sans étendre à l’infini le nombre des États membres, c’est d’abord de réduire le nombre des Européens en créant pour eux tous « un » siège dévolu à l’Union. Un consensus hors d’Europe s’esquisse pour affirmer que les pays européens sont surreprésentés (double représentation de certains États membres au travers des institutions européennes ; existence d’un groupe régional de facto). Avant de s’inquiéter des conséquences algébriques de ce constat, il faut y voir un formidable hommage à la crédibilité de la construction de l’Union et pourquoi pas une opportunité pour un renforcement de la dynamique d’intégration. Avant de subir par la pression conjuguée des États-Unis, de la Russie et des puissances émergentes ce ré-ordonnancement des institutions internationales anciennes ou plus récentes, faisons au moins mine de faire de cette perspective un objectif politique affiché. Cette « bonne volonté » permettra, peut-être, aux États européens de bâtir entre eux de nouveaux mécanismes de convergence et de solidarité mais aussi de choisir leurs « successeurs » dans les enceintes internationales. Au G20, l’instauration d’un siège européen unique en libérera pas moins de quatre, permettant ainsi l’élargissement à de nouveaux émergents et de répondre au besoin d’inclusivité plus forte du groupe. Ceteris paribus, il serait erroné de croire que l’élargissement, facilité par la mise en place d’un siège européen, règlera la question de la légitimité du G20 ou de toute autre organisation. N’oublions pas que le G20 et le foisonnement récent des organisations transnationales est aussi le résultat de l’inefficacité des Nations unies. Le G173 devait donc prendre la création de ces clubs comme une alerte « salutaire » sur leur progressive marginalisation dans la gouvernance mondiale. Néanmoins, si des contributions de qualité sont apportées par l’ONU sur le fond des débats des institutions naissantes qui veulent aider à la réforme de la gouvernance mondiale, les politiques de développement, l’aide aux pays les plus vulnérables… alors le risque de voir l’agenda du G20 ne cesser à l’avenir de s’étendre, diminuera d’autant.23Le G20, comme tous les autres clubs, est un espace politique informel dont les engagements n’ont pas de valeur juridique et ne s’imposent donc pas, ipso facto, aux États non-membres. Il ne représente, ni ne prétend représenter les autres États. En revanche, son poids démographique (deux tiers de la population mondiale), économique (85 % du PIB) et politique en fait un élément original et incontournable de la nouvelle scène internationale. Cela suffit en soi à lui conférer une certaine légitimité et si l’idée de renforcer cette dernière s’impose va dans le bon sens, il conviendra que cela ne se fit pas au détriment de son efficacité. Si certains pays comme le groupe de l’ALBA choisissent de s’opposer à ses décisions ou recommandations, c’est leur affaire mais ils s’isoleront d’eux-mêmes se faisant du reste du monde.24Le processus de consultation du G20 et des Nations unies, récemment imaginé, ôte aux contestataires un argument utile pour rallier des soutiens auprès d’États relativement neutres jusqu’à présent, les isolant à défaut de pouvoir les convaincre. Dans le même temps, l’attitude coopérative des puissances « émergentes » au sein du G20 doit être renforcée car elle limitera le risque que leur solidarité traditionnelle avec le G77 ne les mette en porteà-faux. Il est crucial de faire émerger chez ces nouveaux partenaires un sens plus aigu des responsabilités et des devoirs qui devraient accompagner leur accession à un statut « nouveau » au sein des grandes enceintes internationales de concertation. Toutefois, le maintien des ministres de l’Économie plutôt que des ministres des Affaires étrangères comme chefs de file sur le G20 complique la prise en charge de questions relatives à la gouvernance globale et la coordination avec les Nations unies. C’est d’autant plus dommageable que l’intégration inconditionnelle des émergents a privé les puissances établies du quid pro quo qui était au cœur du processus d’Heiligendamm, lancé en juin 2007 par le G8 sous présidence allemande (cf. participation probatoire à des ateliers où seraient testées la volonté politique et les capacités technico-juridico-administratives des accédants à s’engager sur des agendas collectifs comme condition préalable à une intégration future mais prochaine).25Aujourd’hui, on est dans une situation où les puissances émergentes sont les bénéficiaires d’une « divine surprise ». Sollicitées pour adhérer au club des puissances globales et seules à même de capter l’énergie de l’ensemble des discours critiques de l’ordre mondial, elles sont les « hôtes muets » de la réforme de la gouvernance. Elles se trouvent intégrées au cercle des principales puissances sans avoir eu à exposer leur conception des relations internationales au-delà du rappel de leur attachement à leur souveraineté, ni à se compromettre sur la définition et la promotion de leurs intérêts nationaux. Cet état de fait ne pourra perdurer sans risquer de miner l’objectif d’une refonte de la gouvernance mondiale car il laisserait apparaître le G20 comme l’instrument de manipulation des puissances émergentes par celles qui sont installées depuis longtemps. Dans ce contexte, les États « exclus » ne s’en montreront pas moins attentifs à ce que les compétences des institutions des Nations unies soient préservées, en particulier celles de l’Assemblée générale en matière de réforme du Conseil de sécurité.26Il est donc utile que les Nations unies soient systématiquement associées aux discussions et aux travaux en amont, ce qui ne veut pas dire pour autant que le G20 soit subordonné à l’ONU et à ses agences. Ce mécanisme passera par une formalisation de l’invitation du secrétaire général (SGNU) aux sommets, une association étroite du sherpa du SGNU (Kwame Sundaram Jomo) et son
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


يحتوي على g173
19 الانتفاضة مميزة (مثل التجمعات المخصصة لا انتخابات لا تمثل قوة اقتصادية لا غير، عالمية) تفسير تحفظ الكثير من الأمم السابقة، وخاصة البريك تظهر، يبدو أن مجموعة العشرين."انتفاضة" 173 عضوا في الأمم المتحدة لا تنتمي أو لا في مجموعة العشرين "اليوم".وطلبت تعزيز شرعية مخصصة في التجمع و عمل أفضل رابطة الأمم المتحدة التي أنشئت مؤخرا في السكن.هذه هي جهود مجموعة العشرين أكثر من أي شيء آخر، حتى في هذا المنتدى تقلع الطارئة.وراثة القمم، مرتين في السنة، لا يسمح إنشاء حوار منظم مع غيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة نفسها، لكنها لا تزال قانونية النظام المتعدد الأطراف الجهاز المهم.......
20 بناء الحوار مع الأمم المتحدة، وهذا هو بالتأكيد قوة المواصفاتشرعية نظام تسجيل الوقت....... هذا العمل هو ترجمة استراتيجيات التعلم.الدروس من الفشل، المفاوضات حول المناخ في كوبنهاغن في إقناع حسن القنوات الدبلوماسية، فقط أكثر شمولا من المرجح أن تجنب انقسام في المجتمع الدولي.ومع ذلك، مجموعة العشرين صورة
19 الانتفاضة مميزة (مثل التجمعات المخصصة لا انتخابات لا تمثل قوة اقتصادية لا غير، عالمية) تفسير تحفظ الكثير من الأمم السابقة، وخاصة البريك تظهر، يبدو أن مجموعة العشرين."انتفاضة" 173 عضوا في الأمم المتحدة لا تنتمي أو لا في مجموعة العشرين "اليوم".وطلبت تعزيز شرعية مخصصة في التجمع و عمل أفضل رابطة الأمم المتحدة التي أنشئت مؤخرا في السكن.هذه هي جهود مجموعة العشرين أكثر من أي شيء آخر، حتى في هذا المنتدى تقلع الطارئة.وراثة القمم، مرتين في السنة، لا يسمح إنشاء حوار منظم مع غيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة نفسها، لكنها لا تزال قانونية النظام المتعدد الأطراف الجهاز المهم.......
20 بناء الحوار مع الأمم المتحدة، وهذا هو بالتأكيد قوة المواصفاتشرعية نظام تسجيل الوقت....... هذا العمل هو ترجمة استراتيجيات التعلم.الدروس من الفشل، المفاوضات حول المناخ في كوبنهاغن في إقناع حسن القنوات الدبلوماسية، فقط أكثر شمولا من المرجح أن تجنب انقسام في المجتمع الدولي.ومع ذلك، مجموعة العشرين صورة
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.
- صغيرتي هي حياتي
- It looks like you haven't been on Kik la
- انتي كتير مميزه
- المرهقين
- i'm getting wet baby wanna watch me rub
- N'osera dans un terrain à proximité de u
- 2/La sécurité collective par la diplomat
- هل احد يدخل الحمام وانتي بالداخل
- 2/La sécurité collective par la diplomat
- اشاهد في هاذا النص نصين
- وانا احبك كثيرا يا طفلتي
- activities
- المرهقين
- Bienvenue
- متى عيد ميلادك
- Hows my buddy
- Proximité
- 2/La sécurité collective par la diplomat
- Update 5th Dec 2015: Fixed combat rifle
- Hows my buddy
- Bienvenue
- Haters will say the keeper should have g
- 2/La sécurité collective par la diplomat
- فرج