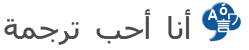- النص
- تاريخ
Tout comme pour les pays du G7, la
Tout comme pour les pays du G7, la diplomatie économique des grandes puissances émergentes doit s’adapter à la mondialisation, et à l’estompement des limites qu’elle entraîne entre les sphères interne et externe. À l’ère de la mobilité des biens, des personnes et des capitaux, cette diplomatie doit constamment se « décentrer », pour intégrer les revendications de divers groupes de pression diffus, qui se substituent à un « intérêt national » défini de manière trop étroite. Là encore, il faut nuancer le propos, selon que l’on considère des États dirigés par un pouvoir exécutif fort ou par des majorités parlementaires. Il faut aussi tenir compte du degré d’autonomie de l’administration – ministère des Affaires étrangères et ministères « sectoriels » chargés de l’Économie et des Finances – par rapport au pouvoir politique. L’existence de traditions diplomatiques bien établies atteste de cette autonomie, comme le montrent les exemples de l’Itamaraty au Brésil ou du MID en Russie [9][9] Ces deux ministères des Relations extérieures possèdent....
8
Cela ne signifie pas pour autant que les États aient renoncé à toute prérogative régalienne en matière de diplomatie économique. Celle-ci reflète in fine la politique économique mise en œuvre sur le plan interne, et il ne faut pas négliger la dimension coercitive de l’« arme économique », surtout lorsqu’elle est utilisée à des fins politiques [10][10] L’acceptation par la Chine et la Russie des sanctions.... De plus, certaines questions comme l’énergie mettent en jeu des intérêts géostratégiques tellement importants, que ces derniers priment souvent sur les considérations purement commerciales, et relèvent en dernier ressort des instances politiques [11][11] On en a eu une illustration en 2005 lorsque le Congrès.... Enfin, les États conservent la haute main sur les questions financières et monétaires, perçues comme des attributs essentiels de la souveraineté. Le débat sur la « guerre des monnaies » et l’absence de consensus au sein des pays du G20 sur les causes des grands déséquilibres de balances courantes – tantôt attribués à la sous-évaluation de la monnaie chinoise, et tantôt à l’endettement excessif des ménages américains – illustrent la permanence d’antagonismes latents, qui relativisent la vision irénique d’un monde entièrement pacifié par le commerce [12][12] Ces antagonismes soulignent aussi en creux les « ratés »....
9
Mais en définitive, la capacité à se projeter à l’extérieur – ce que Joseph Nye appelle le soft power – est beaucoup plus tributaire de la puissance financière, et de l’attractivité per se d’une économie, que de vaines gesticulations politiques. À cet égard, les lois d’airain de l’économie finissent toujours par l’emporter sur les constructions idéologiques. C’est ce que montre l’échec du projet de Nouvel ordre économique international (NOEI), défendu par les pays du Sud dans les années 1970, et le succès, a contrario, des coalitions à géométrie variable entre plusieurs pays émergents dans les années 2000. Dans le premier cas, l’entente entre pays en développement, réunis au sein du G77, était fondée sur la revendication d’un « droit générique au développement » et sur une opposition systématique aux pays du Nord. Mais cette entente a rapidement achoppé sur l’hétérogénéité des situations propres à chaque pays [13][13] Le G77 rassemblait à la fois des pays exportateurs.... Dans le second cas, le G20-Sud constitué autour du Brésil a réussi à « casser » la mainmise des États-Unis et de l’Union européenne sur l’OMC [14][14] Le blocage de la conférence de l’OMC à Cancún en septembre..., à partir d’un constat partagé entre les 20 pays réunis à cette occasion. Le succès de cette « coalition de seconde génération », selon l’expression de Philippe Marchesin [15][15] Voir P. Marchesin, La Revanche du Sud, Paris, L’infini,..., repose sur le pragmatisme, le caractère ciblé des revendications et l’acceptation d’éventuelles divergences sur d’autres questions.
10
À ce propos, la percée diplomatique de la Chine en Afrique dans les années 2000 doit être jugée à l’aune de ce schéma interprétatif, sur la base d’un pragmatisme assumé et de l’acceptation de différences idéologiques – notamment en matière de gouvernance politique – qui n’empêchent pas de développer des partenariats sur le plan économique. Certains parlent même d’un Consensus de Pékin [16][16] Voir J. Ramo Cooper, The Beijing Consensus, The Foreign..., qui se substituerait au Consensus de Washington, pour décrire cette nouvelle relation sino-africaine. Ce Consensus serait fondé sur le respect de la souveraineté politique et sur la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays partenaire. En un sens, c’est une réactualisation des principes de la Charte de Bandung, énoncée en 1955 à l’issue de la conférence du même nom, qui avait jeté les bases du mouvement des non-alignés. Mais, si le discours officiel n’a pas tellement changé, depuis les voyages de Zhou Enlai en Afrique jusqu’à ceux de Hu Jintao, les relations sino-africaines s’inscrivent aujourd’hui dans une logique totalement désidéologisée. Les communiqués publiés à l’issue des sommets sino-africains, dont le premier s’est déroulé à Pékin en novembre 2006, mettent l’accent sur des initiatives concrètes, comme la réduction de la dette des pays africains, et évitent à dessein les questions polémiques.
11
On retrouve cette approche pragmatique chez une puissance moyenne comme la Turquie, dont le dynamisme économique et la position géostratégique exceptionnelle, à cheval entre plusieurs continents, identités et cultures, lui ouvre les horizons d’une diplomatie multipolaire, d’inspiration néo-ottomane. À défaut d’intégrer complètement l’espace européen et de se fondre dans cet espace, où sa spécificité islamique et son poids démographique font peur, la Turquie s’érige en puissance autonome, axant tous ses efforts sur la promotion de ses intérêts économiques et commerciaux. Sous l’égide de son nouveau ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, la diplomatie turque est devenue le meilleur allié des Tigres Anatoliens, ces entrepreneurs du BTP et du textile, proches des milieux islamo-conservateurs de l’AKP, qui sont partis à la conquête des marchés étrangers, du Maghreb à l’Asie centrale, en passant par les Balkans, le Proche-Orient et la Russie. De plus, « utilisant l’Organisation de la conférence islamique (OCI), Ankara a signé de nombreux traités de libre-échange et des accords de libre circulation avec près de 60 pays [17][17] Voir G. Perrier, « Les nouveaux horizons de la diplomatie... ». Dans un habile renversement de perspective, c’est la diplomatie classique qui se met ici au service de la diplomatie économique, cette dernière permettant en retour de consolider une influence régionale, voire mondiale, en accord avec le concept de « profondeur stratégique » défendu par Ahmet Davutoglu [18][18] Selon Davutoglu, la « profondeur stratégique » de la....
12
Dans un registre similaire, les relations d’interdépendance en matière énergétique entre l’Union européenne et la Russie, à travers des projets structurants comme les gazoducs Nord Stream et South Stream, qui relient directement les pays consommateurs du Nord et du Sud de l’Europe aux terminaux gaziers du géant Gazprom [19][19] En contournant les pays de transit (Biélorussie, Ukraine)..., participent pleinement à la renaissance d’une diplomatie russe qui retrouve pied en Europe. Ces projets sont mis en valeur par la Russie pour promouvoir un « agenda » d’intégration multidimensionnel avec le Vieux Continent, à travers des initiatives comme le « traité de sécurité européenne », proposé par le président russe Dmitri Medvedev. Il est trop tôt cependant pour dire si ces initiatives préludent à la construction d’un véritable espace commun entre la Russie et l’UE, ou si elles reflètent simplement des préoccupations de bon voisinage, et le souci de donner un habillage juridique à des rapports de type « clientfournisseur ».
13
Quoi qu’il en soit, tous ces exemples montrent la dimension duale de la diplomatie économique, qui exprime, d’une part, l’instrumentalisation de l’économie par un État, au service de sa politique de puissance, dans l’acception la plus westphalienne du terme [20][20] Telle que l’envisageait par exemple l’empereur allemand... et, d’autre part, le dépassement inéluctable de la logique stato-centrée, à travers l’insertion de l’économie dans des ensembles géographiques de plus en plus vastes, et la prise en compte d’intérêts non étatiques dans la conduite, sinon dans l’élaboration, de la politique étrangère. Les puissances émergentes n’échappent pas à cette dualité, qui va de pair avec l’affaiblissement tendanciel de l’influence des États sur les acteurs non étatiques [21][21] Ce n’est évidemment pas le cas des acteurs étatiques,.... À l’exception des BRIC, dont la diplomatie s’est forgée au fil des décennies, à mesure que leur puissance s’affirmait (ou se réaffirmait), pour nombre de puissances émergentes « moyennes » comme le Mexique, la Corée du Sud ou l’Indonésie, cantonnées auparavant dans une attitude passive de paradigm takers, l’enjeu essentiel consiste aujourd’hui à trouver un positionnement qui reflète cette dualité, sans susciter la méfiance des puissances établies. Dans ce contexte, la construction d’une Realpolitik adaptée aux enjeux du XXIe siècle, entre multilatéralisme de façade et multipolarité effective, passe de plus en plus par la dissociation entre la sphère géostratégique, où l’asymétrie est manifeste avec l’Hégémôn américain et ses challengers immédiats [22][22] De surcroît lorsque ces pays sont liés par des alliances... (Chine, Russie), et la sphère économique, où l’utilisation judicieuse de certains « effets de levier » permet d’acquérir un « droit au chapitre » dans les enceintes internationales.
14
La montée en puissance des « fonds
8
Cela ne signifie pas pour autant que les États aient renoncé à toute prérogative régalienne en matière de diplomatie économique. Celle-ci reflète in fine la politique économique mise en œuvre sur le plan interne, et il ne faut pas négliger la dimension coercitive de l’« arme économique », surtout lorsqu’elle est utilisée à des fins politiques [10][10] L’acceptation par la Chine et la Russie des sanctions.... De plus, certaines questions comme l’énergie mettent en jeu des intérêts géostratégiques tellement importants, que ces derniers priment souvent sur les considérations purement commerciales, et relèvent en dernier ressort des instances politiques [11][11] On en a eu une illustration en 2005 lorsque le Congrès.... Enfin, les États conservent la haute main sur les questions financières et monétaires, perçues comme des attributs essentiels de la souveraineté. Le débat sur la « guerre des monnaies » et l’absence de consensus au sein des pays du G20 sur les causes des grands déséquilibres de balances courantes – tantôt attribués à la sous-évaluation de la monnaie chinoise, et tantôt à l’endettement excessif des ménages américains – illustrent la permanence d’antagonismes latents, qui relativisent la vision irénique d’un monde entièrement pacifié par le commerce [12][12] Ces antagonismes soulignent aussi en creux les « ratés »....
9
Mais en définitive, la capacité à se projeter à l’extérieur – ce que Joseph Nye appelle le soft power – est beaucoup plus tributaire de la puissance financière, et de l’attractivité per se d’une économie, que de vaines gesticulations politiques. À cet égard, les lois d’airain de l’économie finissent toujours par l’emporter sur les constructions idéologiques. C’est ce que montre l’échec du projet de Nouvel ordre économique international (NOEI), défendu par les pays du Sud dans les années 1970, et le succès, a contrario, des coalitions à géométrie variable entre plusieurs pays émergents dans les années 2000. Dans le premier cas, l’entente entre pays en développement, réunis au sein du G77, était fondée sur la revendication d’un « droit générique au développement » et sur une opposition systématique aux pays du Nord. Mais cette entente a rapidement achoppé sur l’hétérogénéité des situations propres à chaque pays [13][13] Le G77 rassemblait à la fois des pays exportateurs.... Dans le second cas, le G20-Sud constitué autour du Brésil a réussi à « casser » la mainmise des États-Unis et de l’Union européenne sur l’OMC [14][14] Le blocage de la conférence de l’OMC à Cancún en septembre..., à partir d’un constat partagé entre les 20 pays réunis à cette occasion. Le succès de cette « coalition de seconde génération », selon l’expression de Philippe Marchesin [15][15] Voir P. Marchesin, La Revanche du Sud, Paris, L’infini,..., repose sur le pragmatisme, le caractère ciblé des revendications et l’acceptation d’éventuelles divergences sur d’autres questions.
10
À ce propos, la percée diplomatique de la Chine en Afrique dans les années 2000 doit être jugée à l’aune de ce schéma interprétatif, sur la base d’un pragmatisme assumé et de l’acceptation de différences idéologiques – notamment en matière de gouvernance politique – qui n’empêchent pas de développer des partenariats sur le plan économique. Certains parlent même d’un Consensus de Pékin [16][16] Voir J. Ramo Cooper, The Beijing Consensus, The Foreign..., qui se substituerait au Consensus de Washington, pour décrire cette nouvelle relation sino-africaine. Ce Consensus serait fondé sur le respect de la souveraineté politique et sur la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays partenaire. En un sens, c’est une réactualisation des principes de la Charte de Bandung, énoncée en 1955 à l’issue de la conférence du même nom, qui avait jeté les bases du mouvement des non-alignés. Mais, si le discours officiel n’a pas tellement changé, depuis les voyages de Zhou Enlai en Afrique jusqu’à ceux de Hu Jintao, les relations sino-africaines s’inscrivent aujourd’hui dans une logique totalement désidéologisée. Les communiqués publiés à l’issue des sommets sino-africains, dont le premier s’est déroulé à Pékin en novembre 2006, mettent l’accent sur des initiatives concrètes, comme la réduction de la dette des pays africains, et évitent à dessein les questions polémiques.
11
On retrouve cette approche pragmatique chez une puissance moyenne comme la Turquie, dont le dynamisme économique et la position géostratégique exceptionnelle, à cheval entre plusieurs continents, identités et cultures, lui ouvre les horizons d’une diplomatie multipolaire, d’inspiration néo-ottomane. À défaut d’intégrer complètement l’espace européen et de se fondre dans cet espace, où sa spécificité islamique et son poids démographique font peur, la Turquie s’érige en puissance autonome, axant tous ses efforts sur la promotion de ses intérêts économiques et commerciaux. Sous l’égide de son nouveau ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, la diplomatie turque est devenue le meilleur allié des Tigres Anatoliens, ces entrepreneurs du BTP et du textile, proches des milieux islamo-conservateurs de l’AKP, qui sont partis à la conquête des marchés étrangers, du Maghreb à l’Asie centrale, en passant par les Balkans, le Proche-Orient et la Russie. De plus, « utilisant l’Organisation de la conférence islamique (OCI), Ankara a signé de nombreux traités de libre-échange et des accords de libre circulation avec près de 60 pays [17][17] Voir G. Perrier, « Les nouveaux horizons de la diplomatie... ». Dans un habile renversement de perspective, c’est la diplomatie classique qui se met ici au service de la diplomatie économique, cette dernière permettant en retour de consolider une influence régionale, voire mondiale, en accord avec le concept de « profondeur stratégique » défendu par Ahmet Davutoglu [18][18] Selon Davutoglu, la « profondeur stratégique » de la....
12
Dans un registre similaire, les relations d’interdépendance en matière énergétique entre l’Union européenne et la Russie, à travers des projets structurants comme les gazoducs Nord Stream et South Stream, qui relient directement les pays consommateurs du Nord et du Sud de l’Europe aux terminaux gaziers du géant Gazprom [19][19] En contournant les pays de transit (Biélorussie, Ukraine)..., participent pleinement à la renaissance d’une diplomatie russe qui retrouve pied en Europe. Ces projets sont mis en valeur par la Russie pour promouvoir un « agenda » d’intégration multidimensionnel avec le Vieux Continent, à travers des initiatives comme le « traité de sécurité européenne », proposé par le président russe Dmitri Medvedev. Il est trop tôt cependant pour dire si ces initiatives préludent à la construction d’un véritable espace commun entre la Russie et l’UE, ou si elles reflètent simplement des préoccupations de bon voisinage, et le souci de donner un habillage juridique à des rapports de type « clientfournisseur ».
13
Quoi qu’il en soit, tous ces exemples montrent la dimension duale de la diplomatie économique, qui exprime, d’une part, l’instrumentalisation de l’économie par un État, au service de sa politique de puissance, dans l’acception la plus westphalienne du terme [20][20] Telle que l’envisageait par exemple l’empereur allemand... et, d’autre part, le dépassement inéluctable de la logique stato-centrée, à travers l’insertion de l’économie dans des ensembles géographiques de plus en plus vastes, et la prise en compte d’intérêts non étatiques dans la conduite, sinon dans l’élaboration, de la politique étrangère. Les puissances émergentes n’échappent pas à cette dualité, qui va de pair avec l’affaiblissement tendanciel de l’influence des États sur les acteurs non étatiques [21][21] Ce n’est évidemment pas le cas des acteurs étatiques,.... À l’exception des BRIC, dont la diplomatie s’est forgée au fil des décennies, à mesure que leur puissance s’affirmait (ou se réaffirmait), pour nombre de puissances émergentes « moyennes » comme le Mexique, la Corée du Sud ou l’Indonésie, cantonnées auparavant dans une attitude passive de paradigm takers, l’enjeu essentiel consiste aujourd’hui à trouver un positionnement qui reflète cette dualité, sans susciter la méfiance des puissances établies. Dans ce contexte, la construction d’une Realpolitik adaptée aux enjeux du XXIe siècle, entre multilatéralisme de façade et multipolarité effective, passe de plus en plus par la dissociation entre la sphère géostratégique, où l’asymétrie est manifeste avec l’Hégémôn américain et ses challengers immédiats [22][22] De surcroît lorsque ces pays sont liés par des alliances... (Chine, Russie), et la sphère économique, où l’utilisation judicieuse de certains « effets de levier » permet d’acquérir un « droit au chapitre » dans les enceintes internationales.
14
La montée en puissance des « fonds
0/5000
أما بالنسبة لبلدان مجموعة ال 7 الدبلوماسية الاقتصادية للدول الناشئة الكبرى يجب أن تتكيف مع العولمة، وعدم وضوح الحدود فإنه ينشئ بين الصعيدين الداخلي والخارجي. في عصر تنقل السلع والأشخاص ورؤوس الأموال، وهذه الدبلوماسية يجب باستمرار هو "يزيل التباؤر" لإدماج متطلبات مختلف مجموعات الضغط منتشر، التي تكون بديلاً عن "مصلحة وطنية" تعريف نطاق ضيق جداً. هنا مرة أخرى، أننا يجب أن يتأهل الاتصال، اعتماداً على إذا نحن نعتبر الدول قضت بهيئة تنفيذية الثابت أو بالأغلبية البرلمانية. كما يجب أن تراعي درجة من الحكم الذاتي للإدارة-وزارة الشؤون الخارجية ووزارات الاقتصاد والمالية "القطاعية"-من السلطة السياسية. ويشهد وجود تقاليد الدبلوماسية الراسخة لهذا الحكم الذاتي، كأمثلة ايتاماراتي في البرازيل أو MID في روسيا [9] [9] أن هاتين الإدارتين "العلاقات الخارجية"...8 وهذا لا يعني أن الدول تخلت عن جميع الحقوق السيادية في الدبلوماسية الاقتصادية. وهو يعكس في غرامة الاقتصادية السياسات المنفذة داخليا، ولا تهمل البعد القسرية "السلاح الاقتصادي"، لا سيما عندما يتم استخدامها لأغراض سياسية، [10] [10] بقبول الصين وروسيا للعقوبات... وبالإضافة إلى ذلك، تشمل قضايا مثل الطاقة الجيواستراتيجي مصالح هامة جداً، وأن هذا الأخير غالباً ما تفوق اعتبارات تجارية بحتة، وهي في الربيع الماضي من الهيئات السياسية [11] [11] وكان مثالاً في عام 2005 عندما الكونغرس... وأخيراً، الدول تحتفظ باليد العليا في المسائل المالية والنقدية، ينظر إليها على أنها سمات السيادة الأساسية. المناقشة بشأن "حرب العملات"، وعدم وجود توافق في الآراء داخل بلدان مجموعة ال 20 على أسباب اختلالات الحساب الجاري كبيرة-وفي بعض الأحيان تعزى إلى بخس قيمة العملة الصينية، وديون الأسر الأمريكية المفرطة في بعض الأحيان-توضيح دوام العداوات الكامنة، التي ريلاتيفيسي الرؤية إثبات عالما سلميا تماما بالتجارة [12] [12] هذه العداوات نؤكد أيضا الحفر "فشل"...9ولكن في نهاية المطاف، القدرة على المشروع نفسه خارج-ناي جوزيف ما يسمى القوة الناعمة-أكثر اتكالا على القوة المالية وجاذبية كل من الاقتصاد، فارغة المواقف السياسية. وفي هذا الصدد، تسود قوانين الاقتصاد النحاس دائماً في نهاية المطاف على الإنشاءات الأيديولوجية. ما يبين فشل المشروع للنظام الاقتصادي الدولي الجديد (نييو)، يدافع عنها بلدان الجنوب في السبعينات، والنجاح الذي حققه، على العكس من ذلك، ائتلافات للهندسة المتغيرة بين العديد من البلدان الناشئة في 2000s. ففي الحالة الأولى، استند الاتفاق بين البلدان النامية، اجتماع داخل مجموعة ال 77، على مطالبة 'عامة الحق في التنمية' ومعارضة منتظمة للبلدان الشمال. ولكن هذا الاتفاق قد اندلعت بسرعة إلى أسفل على تباين الأوضاع المحددة لكل بلد [13] [13] مجموعة ال 77 التي جمعت كل من المصدرين... وفي الحالة الثانية، تمكنت G20-الجنوب حول البرازيل 'كسر' الاستيلاء على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية [14] [14] بحظر مؤتمر منظمة التجارة العالمية في كانكون في أيلول/سبتمبر، من استنتاج مشترك بين 20 بلدا واجتمع في هذه المناسبة. نجاح هذا 'الجيل الثاني من تحالف'، على حد تعبير Philippe مارتشيسين [15] [15] انظر ص مارتشيسين، الانتقام من الجنوب، باريس، اللانهاية،...، يرتكز على البراغماتية والمطالبات الحرف المستهدفة وقبول الاختلافات المحتملة في قضايا أخرى.10وفي هذا الصدد، يجب أن يحاكم اختراقه دبلوماسية الصين في أفريقيا في عام 2000 بمعيار هذا المخطط تفسيرية، على أساس واقعية مفترضة وقبول الاختلافات الأيديولوجية--بما في ذلك الإدارة السياسية-التي لا تمنع إقامة شراكات في الخطة الاقتصادية. بعض الحديث عن "توافق بكين" [16] [16] انظر J. رامو كوبر، توافق بكين، "الخارجية"..., الذي سيحل محل "توافق آراء واشنطن" لوصف هذه العلاقة الصينية-الأفريقية الجديدة. توافق الآراء هذا سيعتمد على احترام السيادة السياسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الشريك. بمعنى، هذا هو تحديث مبادئ "الميثاق باندونغ" المبينة في عام 1955 في نهاية المؤتمر الذي يحمل نفس الاسم، الذي أرسى الأسس لحركة عدم الانحياز. ولكن إذا كان الخطاب الرسمي لا تتغير منذ رحلات "تشو أن لأي" في أفريقيا لهو جين تاو، العلاقات الصينية اليوم تماما منطق ديسيديولوجيسي. النشرات في نهاية قمم الصينية، التي عقدت في بكين في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، التركيز على مبادرات ملموسة، مثل تخفيض ديون البلدان الأفريقية، الأول وتعمدت تجنب القضايا المثيرة للجدل.11أننا نجد هذا النهج العملي في قوة متوسط كما أن تركيا، بما في ذلك الدينامية الاقتصادية والوضع الجيواستراتيجي الاستثنائي عدة قارات والهويات والثقافات، فإنه يفتح آفاق دبلوماسية متعدد الأقطاب للإلهام النيو-العثمانية. عدم الاندماج تماما في المنطقة الأوروبية والذوبان في هذا الفضاء، حيث تخويف خصوصيته الإسلامية وثقلها الديمغرافي، بنيات تركيا في سلطة الحكم الذاتي، تركز كل جهودها على تعزيز مصالحها الاقتصادية والتجارية. تحت رعاية وزير خارجيتها الجديد، أحمد داود أوغلو، أصبحت الدبلوماسية التركية أفضل حليف "نمور الأناضول"، هؤلاء المقاولين للبناء، والمنسوجات، قريبة من دوائر عقائدية والمحافظين في حزب العدالة والتنمية، الذي ذهب إلى الاستيلاء على الأسواق الخارجية للمغرب العربي إلى آسيا الوسطى، مرورا بالبلقان والشرق الأوسط وروسيا. وبالإضافة إلى ذلك، "استخدام منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي)، وقعت أنقرة العديد من المعاهدات المتعلقة بالتجارة الحرة واتفاقات حرية الحركة مع ما يقرب من 60 بلدا [17] [17] انظر زاي بيرييه، «آفاق جديدة للدبلوماسية...» ». بعكس ذكية للمنظور، هو الدبلوماسية التقليدية التي تبدأ هنا في خدمة الدبلوماسية الاقتصادية، ظهر هذا الأخير لتوطيد نفوذ الإقليمي، وحتى العالمي وفقا لمفهوم "العمق الاستراتيجي" الذي يدافع عن أحمد داود أوغلو [18] [18] وفقا لداود أوغلو، "العمق الاستراتيجي"...12في سياق مماثل، علاقات الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، من خلال مشاريع متكاملة مثل تيار الشمال والجنوب تيار أنابيب البلدان المستهلكة مباشرة تربط بين شمال وجنوب أوروبا الغاز العملاقة جازبروم محطات [19] [19] تجاوز بلدان المرور العابر (بيلاروس، أوكرانيا)، تشارك مشاركة تامة في أحياء الدبلوماسية الروسية التي وجدت لها موطئ قدم في أوروبا. يتم تمييز هذه المشاريع لروسيا لتعزيز 'خطة' التكامل متعدد الأبعاد مع القارة القديمة، من خلال مبادرات مثل "معاهدة الأمن الأوروبي"، اقترحه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف. ولكن من المبكر جداً أن نقول إذا هذه المبادرات التي تؤدي إلى بناء منطقة مشتركة حقيقية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كانت تعكس ببساطة تتعلق بحسن الجوار والرغبة في إعطاء غطاء قانوني لتقارير من نوع 'كلينتفورنيسيور'.13Quoi qu’il en soit, tous ces exemples montrent la dimension duale de la diplomatie économique, qui exprime, d’une part, l’instrumentalisation de l’économie par un État, au service de sa politique de puissance, dans l’acception la plus westphalienne du terme [20][20] Telle que l’envisageait par exemple l’empereur allemand... et, d’autre part, le dépassement inéluctable de la logique stato-centrée, à travers l’insertion de l’économie dans des ensembles géographiques de plus en plus vastes, et la prise en compte d’intérêts non étatiques dans la conduite, sinon dans l’élaboration, de la politique étrangère. Les puissances émergentes n’échappent pas à cette dualité, qui va de pair avec l’affaiblissement tendanciel de l’influence des États sur les acteurs non étatiques [21][21] Ce n’est évidemment pas le cas des acteurs étatiques,.... À l’exception des BRIC, dont la diplomatie s’est forgée au fil des décennies, à mesure que leur puissance s’affirmait (ou se réaffirmait), pour nombre de puissances émergentes « moyennes » comme le Mexique, la Corée du Sud ou l’Indonésie, cantonnées auparavant dans une attitude passive de paradigm takers, l’enjeu essentiel consiste aujourd’hui à trouver un positionnement qui reflète cette dualité, sans susciter la méfiance des puissances établies. Dans ce contexte, la construction d’une Realpolitik adaptée aux enjeux du XXIe siècle, entre multilatéralisme de façade et multipolarité effective, passe de plus en plus par la dissociation entre la sphère géostratégique, où l’asymétrie est manifeste avec l’Hégémôn américain et ses challengers immédiats [22][22] De surcroît lorsque ces pays sont liés par des alliances... (Chine, Russie), et la sphère économique, où l’utilisation judicieuse de certains « effets de levier » permet d’acquérir un « droit au chapitre » dans les enceintes internationales.14صعود 'الصندوق'.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


وبالنسبة للدول G7، الدبلوماسية الاقتصادية للقوى الناشئة كبيرة يجب أن تتكيف مع العولمة وعدم وضوح الحدود بين أنه يسبب المجالات الداخلية والخارجية. في عصر تنقل البضائع والأشخاص ورؤوس الأموال، هذه الدبلوماسية يجب باستمرار "مركز بعيدة عن" ليشمل المطالبات من مختلف جماعات الضغط منتشر، التي تحل محل "المصلحة الوطنية" للغاية محددة بدقة . مرة أخرى، يجب علينا التأهل الطريق، اعتمادا على ما إذا ما أخذنا في الاعتبار الدول التي تقودها سلطة تنفيذية قوية أو الأغلبيات البرلمانية. يجب علينا أيضا النظر في درجة استقلالية الإدارة - وزارة الشؤون الخارجية والوزارات "القطاعية" الاقتصاد والمالية - من السلطة السياسية. وجود تقاليد دبلوماسية راسخة يشهد على هذا الحكم الذاتي، والأمثلة من البرازيل وإيتاماراتي MID في روسيا [9] [9] هذه زارتي الشؤون الخارجية لها ....
8
وهذا لا يعني لا يعني أن الدول قد تخلت عن حق ملكي من حيث الدبلوماسية الاقتصادية. وهذا يعكس في النهاية تنفيذ السياسة الاقتصادية داخليا، وأنه لا ينبغي أن يغفل البعد القسري لل"سلاح المقاطعة الاقتصادية" وخصوصا عند استخدامها لأغراض سياسية [10] [10] قبول روسيا والصين لفرض عقوبات .... وبالإضافة إلى ذلك، قضايا مثل الطاقة تنطوي على مصالح الجيو استراتيجي مهم جدا، وهذه الأخيرة غالبا ما تكون لها الأسبقية على الاعتبارات التجارية، وهي في نهاية المطاف الهيئات السياسية [11] [11] كان لدينا مثال في عام 2005 عندما الكونجرس .... وأخيرا، تحتفظ الدول السيطرة على المسائل المالية والنقدية، وينظر إليها على أنها سمات الأساسية للسيادة. النقاش حول "حرب العملات"، وعدم وجود إجماع داخل G20 عن أسباب الاختلالات كبير في الحساب الجاري - يعزى في بعض الأحيان إلى بخس قيمة العملة الصينية، وأحيانا في الديون المفرطة من الأسر في الولايات المتحدة - توضيح دوام العداوات الكامنة، التي نسبية الرؤية الحانق من عالم سلمي تماما من خلال التجارة [12] [12] هذه العداوات أيضا التأكيد على "فشل" جوفاء ....
9
ولكن في النهاية القدرة على المشروع إلى الخارج - ما يسمى جوزيف ناي القوة الناعمة - هي تعتمد على القوة المالية وجاذبية الاقتصاد في حد ذاته أكثر من ذلك بكثير، من مواقف سياسية فارغة. في هذا الصدد، والاقتصاد من القوانين وقحة تنتهي دائما الغلبة على ثوابت عقائدية. ويتضح ذلك من فشل النظام المقترح اقتصادي دولي جديد (NIEO)، الذي دافع عنه الجنوب في 1970s، والنجاح، على العكس، تحالفات الهندسة المتغيرة بين عدة اقتصادات الناشئة في السنوات 2000. ففي الحالة الأولى، فإن الاتفاق بين البلدان النامية، وتلبية داخل G77، كانت تقوم على المطالبة "حق عام في التنمية" والمعارضة منهجية لكوريا الشمالية. لكن هذا الاتفاق انهار بسرعة على تباين الأوضاع الخاصة بكل بلد [13] [13] جلب G77 معا كلا من البلدان المصدرة .... وفي الحالة الثانية، وG20-جنوب تشكلت حول البرازيل تمكنت إلى "كسر" القبضة الخانقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منظمة التجارة العالمية [14] [14] حجب مؤتمر منظمة التجارة العالمية في كانكون في سبتمبر ... من المراقبة المشتركة تجمع بين 20 دولة لهذه المناسبة. نجاح هذا "التحالف الجيل الثاني"، على حد قول فيليب Marchesin [15] [15] انظر P. Marchesin، الثأر من الجنوب، باريس، إنفينيتي، ...، على أساس البراغماتية، طبيعة المستهدفة من المطالبات والخلافات قبول الممكنة في قضايا أخرى.
10
وفي هذا الصدد، ينبغي الحكم على انفراجة دبلوماسية الصين في أفريقيا في 2000s فقا لمعايير هذا المخطط التفسيري، استنادا براغماتية يفترض وقبول الاختلافات الأيديولوجية - لا سيما من حيث الحكم السياسي - أن لا تمنع تطوير شراكات من الناحية الاقتصادية. حتى بعض الحديث عن إجماع بكين [16] [16] انظر J. كوبر رامو، توافق بكين، والخارجية ... التي ستحل محل إجماع واشنطن، لوصف هذه العلاقات الصينية الافريقية الجديدة. وسيستند هذا الإجماع على احترام السيادة السياسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشريكة. بمعنى، هو استكمال لمبادئ ميثاق باندونغ، تعيين في عام 1955 في نهاية المؤتمر الذي يحمل نفس الاسم، والذي وضع الأساس لحركة عدم الانحياز. ولكن إذا كان الخطاب الرسمي لم يتغير الكثير منذ تشو ان لاى رحلات إلى أفريقيا لتلك التي هو جين تاو، والعلاقات بين الصين وأفريقيا هي جزء اليوم في منطق العقائديين تماما. اتخذت النشرات صدر عقب القمة الصينية الأفريقية، وهي الأولى من التي تجري في بكين في نوفمبر 2006، مع التركيز على مبادرات ملموسة، مثل تخفيض ديون البلدان الأفريقية، وتجنب عمدا القضايا المثيرة للجدل.
11
نجد هذا النهج العملي في قوة المتوسطة مثل تركيا، التي الديناميكية الاقتصادية والجيوستراتيجية موقف استثنائي، تمتد عدة قارات والثقافات والهويات، ويفتح آفاق دبلوماسية متعددة الأقطاب والإلهام العثمانية الجديدة. الفشل في الاندماج الكامل في المنطقة الأوروبية ومزج في هذا المجال، حيث له خصوصية الإسلامية وثقلها السكاني مخيف، تركيا تقف كقوة مستقلة، مع التركيز كل جهودها على تعزيز مصالحها الاقتصادية و الأعمال. تحت رعاية وزير خارجيتها الجديد، أحمد داود أوغلو، أصبحت الدبلوماسية التركية أفضل حليف للالأناضول نمور، هذه المشاريع بناء والنسيج، على مقربة من الأوساط الإسلامية المحافظ من حزب العدالة والتنمية، الذي غادر غزو الأسواق الخارجية وشمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى، عبر البلقان والشرق الأوسط وروسيا. بالإضافة إلى ذلك، "عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC)، وقعت أنقرة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات حرية التنقل مع ما يقرب من 60 بلدا [17] [17] انظر G. بيرير،" إن آفاق جديدة للدبلوماسية ... ". في تحول ذكي من منظور، هو الدبلوماسية الكلاسيكية التي تبدأ هنا في خدمة الدبلوماسية الاقتصادية، وهذا الأخير في العودة لتوطيد النفوذ الإقليمي، أو حتى العالمي، بالاتفاق مع مفهوم "العمق الاستراتيجي" التي يدافع عنها أحمد داود أوغلو [18] [18] وفقا لداود أوغلو، و"العمق الاستراتيجي" لل....
12
في سجل مماثل، وترابط العلاقات في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، من خلال المشاريع الهيكلية مثل أنابيب نورد ستريم وساوث ستريم الذي يربط بشكل مباشر على الدول المستهلكة من شمال وجنوب أوروبا إلى محطات الغاز غازبروم [19] [19] العملاقة من خلال تجاوز بلدان العبور (بيلاروس وأوكرانيا) ... تشارك مشاركة كاملة في إحياء الدبلوماسية الروسية العثور على موطئ قدم في أوروبا. وتتعزز هذه المشاريع من قبل روسيا لتعزيز "أجندة" التكامل متعدد الأبعاد مع العالم القديم، من خلال مبادرات مثل "معاهدة الأمن الأوروبي" الذي اقترحه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه المبادرات هي مقدمة لبناء منطقة مشتركة حقيقية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أو إذا كانت ببساطة تعكس قلق حسن الجوار، والحرص على توفير الخلفية القانونية للإبلاغ اكتب "clientfournisseur."
13
ومع ذلك، تظهر هذه الأمثلة البعد المزدوج للدبلوماسية الاقتصادية، والذي يعبر من جهة، وinstrumentalisation الاقتصاد من قبل الدولة في خدمة سياستها السلطة، بمعنى أكثر ويستفاليا كلمة [20] [20] وكما كان مقررا سبيل المثال الإمبراطور الألماني ... ومن ناحية أخرى، فإن النجاح لا مفر منه من منطق محورها ستاتو، من خلال دمج الاقتصاد في مناطق جغرافية أوسع، وإدراج الفائدة غير الحكومية في ركوب الخيل، وإلا في تطوير السياسة الخارجية. القوى الناشئة ليست محصنة ضد هذه الازدواجية، التي يسير جنبا إلى جنب مع ضعف الاتجاه من تأثير الدول على الجهات الفاعلة غير الحكومية [21] [21] ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال من الجهات الحكومية. ... وباستثناء بريك، الذي الدبلوماسية قد بنيت على مدى عقود من الزمن، كما أكد قوتهم (أو التأكيد)، للعديد من القوى الناشئة "المتوسط" مثل المكسيك وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، تقتصر في السابق إلى محتجزي السلبي للنموذج، والتحدي الأساسي اليوم هو العثور على الموقف الذي يعكس هذه الازدواجية، دون إثارة الشكوك من السلطات القائمة. في هذا السياق، وبناء على السياسة الواقعية تكييفها لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بين التعددية وتعدد الأقطاب واجهة فعالة، يمر أكثر وأكثر من التفكك بين المجال الجغرافي الاستراتيجي، حيث التباين واضح مع الهيمنة الأمريكية و منافسيه على الفور [22] [22] وعلاوة على ذلك، عندما ترتبط هذه البلدان عن طريق التحالفات ... (الصين وروسيا)، والمجال الاقتصادي، حيث الاستخدام الحكيم للبعض "النفوذ" يمكن أن يكتسب "الحق في الفصل" في المحافل الدولية.
14
صعود "صندوق
8
وهذا لا يعني لا يعني أن الدول قد تخلت عن حق ملكي من حيث الدبلوماسية الاقتصادية. وهذا يعكس في النهاية تنفيذ السياسة الاقتصادية داخليا، وأنه لا ينبغي أن يغفل البعد القسري لل"سلاح المقاطعة الاقتصادية" وخصوصا عند استخدامها لأغراض سياسية [10] [10] قبول روسيا والصين لفرض عقوبات .... وبالإضافة إلى ذلك، قضايا مثل الطاقة تنطوي على مصالح الجيو استراتيجي مهم جدا، وهذه الأخيرة غالبا ما تكون لها الأسبقية على الاعتبارات التجارية، وهي في نهاية المطاف الهيئات السياسية [11] [11] كان لدينا مثال في عام 2005 عندما الكونجرس .... وأخيرا، تحتفظ الدول السيطرة على المسائل المالية والنقدية، وينظر إليها على أنها سمات الأساسية للسيادة. النقاش حول "حرب العملات"، وعدم وجود إجماع داخل G20 عن أسباب الاختلالات كبير في الحساب الجاري - يعزى في بعض الأحيان إلى بخس قيمة العملة الصينية، وأحيانا في الديون المفرطة من الأسر في الولايات المتحدة - توضيح دوام العداوات الكامنة، التي نسبية الرؤية الحانق من عالم سلمي تماما من خلال التجارة [12] [12] هذه العداوات أيضا التأكيد على "فشل" جوفاء ....
9
ولكن في النهاية القدرة على المشروع إلى الخارج - ما يسمى جوزيف ناي القوة الناعمة - هي تعتمد على القوة المالية وجاذبية الاقتصاد في حد ذاته أكثر من ذلك بكثير، من مواقف سياسية فارغة. في هذا الصدد، والاقتصاد من القوانين وقحة تنتهي دائما الغلبة على ثوابت عقائدية. ويتضح ذلك من فشل النظام المقترح اقتصادي دولي جديد (NIEO)، الذي دافع عنه الجنوب في 1970s، والنجاح، على العكس، تحالفات الهندسة المتغيرة بين عدة اقتصادات الناشئة في السنوات 2000. ففي الحالة الأولى، فإن الاتفاق بين البلدان النامية، وتلبية داخل G77، كانت تقوم على المطالبة "حق عام في التنمية" والمعارضة منهجية لكوريا الشمالية. لكن هذا الاتفاق انهار بسرعة على تباين الأوضاع الخاصة بكل بلد [13] [13] جلب G77 معا كلا من البلدان المصدرة .... وفي الحالة الثانية، وG20-جنوب تشكلت حول البرازيل تمكنت إلى "كسر" القبضة الخانقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منظمة التجارة العالمية [14] [14] حجب مؤتمر منظمة التجارة العالمية في كانكون في سبتمبر ... من المراقبة المشتركة تجمع بين 20 دولة لهذه المناسبة. نجاح هذا "التحالف الجيل الثاني"، على حد قول فيليب Marchesin [15] [15] انظر P. Marchesin، الثأر من الجنوب، باريس، إنفينيتي، ...، على أساس البراغماتية، طبيعة المستهدفة من المطالبات والخلافات قبول الممكنة في قضايا أخرى.
10
وفي هذا الصدد، ينبغي الحكم على انفراجة دبلوماسية الصين في أفريقيا في 2000s فقا لمعايير هذا المخطط التفسيري، استنادا براغماتية يفترض وقبول الاختلافات الأيديولوجية - لا سيما من حيث الحكم السياسي - أن لا تمنع تطوير شراكات من الناحية الاقتصادية. حتى بعض الحديث عن إجماع بكين [16] [16] انظر J. كوبر رامو، توافق بكين، والخارجية ... التي ستحل محل إجماع واشنطن، لوصف هذه العلاقات الصينية الافريقية الجديدة. وسيستند هذا الإجماع على احترام السيادة السياسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشريكة. بمعنى، هو استكمال لمبادئ ميثاق باندونغ، تعيين في عام 1955 في نهاية المؤتمر الذي يحمل نفس الاسم، والذي وضع الأساس لحركة عدم الانحياز. ولكن إذا كان الخطاب الرسمي لم يتغير الكثير منذ تشو ان لاى رحلات إلى أفريقيا لتلك التي هو جين تاو، والعلاقات بين الصين وأفريقيا هي جزء اليوم في منطق العقائديين تماما. اتخذت النشرات صدر عقب القمة الصينية الأفريقية، وهي الأولى من التي تجري في بكين في نوفمبر 2006، مع التركيز على مبادرات ملموسة، مثل تخفيض ديون البلدان الأفريقية، وتجنب عمدا القضايا المثيرة للجدل.
11
نجد هذا النهج العملي في قوة المتوسطة مثل تركيا، التي الديناميكية الاقتصادية والجيوستراتيجية موقف استثنائي، تمتد عدة قارات والثقافات والهويات، ويفتح آفاق دبلوماسية متعددة الأقطاب والإلهام العثمانية الجديدة. الفشل في الاندماج الكامل في المنطقة الأوروبية ومزج في هذا المجال، حيث له خصوصية الإسلامية وثقلها السكاني مخيف، تركيا تقف كقوة مستقلة، مع التركيز كل جهودها على تعزيز مصالحها الاقتصادية و الأعمال. تحت رعاية وزير خارجيتها الجديد، أحمد داود أوغلو، أصبحت الدبلوماسية التركية أفضل حليف للالأناضول نمور، هذه المشاريع بناء والنسيج، على مقربة من الأوساط الإسلامية المحافظ من حزب العدالة والتنمية، الذي غادر غزو الأسواق الخارجية وشمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى، عبر البلقان والشرق الأوسط وروسيا. بالإضافة إلى ذلك، "عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC)، وقعت أنقرة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات حرية التنقل مع ما يقرب من 60 بلدا [17] [17] انظر G. بيرير،" إن آفاق جديدة للدبلوماسية ... ". في تحول ذكي من منظور، هو الدبلوماسية الكلاسيكية التي تبدأ هنا في خدمة الدبلوماسية الاقتصادية، وهذا الأخير في العودة لتوطيد النفوذ الإقليمي، أو حتى العالمي، بالاتفاق مع مفهوم "العمق الاستراتيجي" التي يدافع عنها أحمد داود أوغلو [18] [18] وفقا لداود أوغلو، و"العمق الاستراتيجي" لل....
12
في سجل مماثل، وترابط العلاقات في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، من خلال المشاريع الهيكلية مثل أنابيب نورد ستريم وساوث ستريم الذي يربط بشكل مباشر على الدول المستهلكة من شمال وجنوب أوروبا إلى محطات الغاز غازبروم [19] [19] العملاقة من خلال تجاوز بلدان العبور (بيلاروس وأوكرانيا) ... تشارك مشاركة كاملة في إحياء الدبلوماسية الروسية العثور على موطئ قدم في أوروبا. وتتعزز هذه المشاريع من قبل روسيا لتعزيز "أجندة" التكامل متعدد الأبعاد مع العالم القديم، من خلال مبادرات مثل "معاهدة الأمن الأوروبي" الذي اقترحه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه المبادرات هي مقدمة لبناء منطقة مشتركة حقيقية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، أو إذا كانت ببساطة تعكس قلق حسن الجوار، والحرص على توفير الخلفية القانونية للإبلاغ اكتب "clientfournisseur."
13
ومع ذلك، تظهر هذه الأمثلة البعد المزدوج للدبلوماسية الاقتصادية، والذي يعبر من جهة، وinstrumentalisation الاقتصاد من قبل الدولة في خدمة سياستها السلطة، بمعنى أكثر ويستفاليا كلمة [20] [20] وكما كان مقررا سبيل المثال الإمبراطور الألماني ... ومن ناحية أخرى، فإن النجاح لا مفر منه من منطق محورها ستاتو، من خلال دمج الاقتصاد في مناطق جغرافية أوسع، وإدراج الفائدة غير الحكومية في ركوب الخيل، وإلا في تطوير السياسة الخارجية. القوى الناشئة ليست محصنة ضد هذه الازدواجية، التي يسير جنبا إلى جنب مع ضعف الاتجاه من تأثير الدول على الجهات الفاعلة غير الحكومية [21] [21] ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال من الجهات الحكومية. ... وباستثناء بريك، الذي الدبلوماسية قد بنيت على مدى عقود من الزمن، كما أكد قوتهم (أو التأكيد)، للعديد من القوى الناشئة "المتوسط" مثل المكسيك وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، تقتصر في السابق إلى محتجزي السلبي للنموذج، والتحدي الأساسي اليوم هو العثور على الموقف الذي يعكس هذه الازدواجية، دون إثارة الشكوك من السلطات القائمة. في هذا السياق، وبناء على السياسة الواقعية تكييفها لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بين التعددية وتعدد الأقطاب واجهة فعالة، يمر أكثر وأكثر من التفكك بين المجال الجغرافي الاستراتيجي، حيث التباين واضح مع الهيمنة الأمريكية و منافسيه على الفور [22] [22] وعلاوة على ذلك، عندما ترتبط هذه البلدان عن طريق التحالفات ... (الصين وروسيا)، والمجال الاقتصادي، حيث الاستخدام الحكيم للبعض "النفوذ" يمكن أن يكتسب "الحق في الفصل" في المحافل الدولية.
14
صعود "صندوق
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


كما أن الدبلوماسية الاقتصادية في بلدان مجموعة السبع الدول الناشئة يجب التكيف مع العولمة و غامض بسبب الكرة بين القيود الداخلية والخارجية.في عصر تدفق السلع ورأس المال، موظفي الدبلوماسية يجب أن تستمر "الخروج"سوف يتطلب نشر مختلف جماعات الضغط، و "المصلحة الوطنية" التعريف الضيق.هنا، ونحن يجب أن تستوفي يعتقد حسب الدولة من تنفيذ قوية أو من الأغلبية البرلمانية.ونحن بحاجة أيضا إلى النظر في مستوى إدارة الحكم الذاتي – وزارة الخارجية المسؤول عن "الحكومة الاقتصادية والمالية – بالنسبة إلى السلطة السياسية.وجود التقاليد الدبلوماسية المعمول بها تبين أن هذا الحكممن خلال أمثلة تبين أن رأس المال بازل البرازيل أو بوم russie [9] [9] هذين القطاعين في العلاقات الخارجية..............
8، وهذا لا يعني أن أمريكا قد تخلت عن أي امتيازات السيادة الاقتصادية الخارجية.وهذا يعكس دقة تنفيذ السياسات الاقتصادية الداخليةينبغي عدم تجاهل البعد الاقتصادي "الأسلحة" القسري، وخاصة عندما تستخدم politiques [10] [10] تقبل الصين و روسيا من العقوبات.وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المشاكل، مثل الطاقة تلعب دورا مهم جدا المصالح الجيوسياسية، أيهما أبعد، في كثير من الأحيان محض الاعتبارات التجارية،في الربيع الماضي، على سبيل المثال politiques ينتمي إلى [11] [11] لقد وصف الكونجرس في عام 2005.وأخيرا، فإن الولايات المتحدة الاحتفاظ القضايا النقدية والمالية طبيعة السيادة.في "حرب العملات" و عدم وجود توافق في الآراء، الاختلالات في الحساب الجاري في دول مجموعة العشرين السبب الرئيسي -- في بعض الأحيان بسبب مقومة بأقل من قيمتها، وأحيانا أكثر مديونية الأسر الأمريكية – أن احتمال دائم المعارضة؛relativisent دفع المصالحة البصرية في العالم سلمية تماما commerce [12] [12] هذه المعارضات أيضا على "خاسر" الجوف...
، ولكن في نهاية المطاف، قدرة 9 خارج المشروع، جوزيف ناي - ما يسمى القوة الناعمة أكثر اعتمادا على القوة المالية و الاقتصادية، جاذبية،
8، وهذا لا يعني أن أمريكا قد تخلت عن أي امتيازات السيادة الاقتصادية الخارجية.وهذا يعكس دقة تنفيذ السياسات الاقتصادية الداخليةينبغي عدم تجاهل البعد الاقتصادي "الأسلحة" القسري، وخاصة عندما تستخدم politiques [10] [10] تقبل الصين و روسيا من العقوبات.وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المشاكل، مثل الطاقة تلعب دورا مهم جدا المصالح الجيوسياسية، أيهما أبعد، في كثير من الأحيان محض الاعتبارات التجارية،في الربيع الماضي، على سبيل المثال politiques ينتمي إلى [11] [11] لقد وصف الكونجرس في عام 2005.وأخيرا، فإن الولايات المتحدة الاحتفاظ القضايا النقدية والمالية طبيعة السيادة.في "حرب العملات" و عدم وجود توافق في الآراء، الاختلالات في الحساب الجاري في دول مجموعة العشرين السبب الرئيسي -- في بعض الأحيان بسبب مقومة بأقل من قيمتها، وأحيانا أكثر مديونية الأسر الأمريكية – أن احتمال دائم المعارضة؛relativisent دفع المصالحة البصرية في العالم سلمية تماما commerce [12] [12] هذه المعارضات أيضا على "خاسر" الجوف...
، ولكن في نهاية المطاف، قدرة 9 خارج المشروع، جوزيف ناي - ما يسمى القوة الناعمة أكثر اعتمادا على القوة المالية و الاقتصادية، جاذبية،
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.
- اشعر بوحدة قاسية الان
- Taga saan ka
- كلي امل رغم الالم
- نعم
- تعالي الي مصر
- اشعر بوحدة قاسية الان
- كيف انتي
- FrançaisAu début des années 1990, la vic
- نيسان
- FrançaisAu début des années 1990, la vic
- I just came to a friends house for a vis
- Have this
- What do you think are interesting jobs?
- And the lady owner
- الهاشميه
- في
- من الظهران
- how about abook
- ليه
- العنود القحطاني
- Next time
- هل تشاركيني حلمي
- احب الجو الهادى والممتع
- Goodmorning also